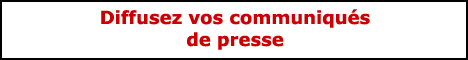Liban
et Phénicie

Libanais
et Phéniciens
|

Découvrez Tanit by Phenicity, bijou et signe
de reconnaissance phénicien
& symbole de la déesse protectrice de la fécondité
et de l'enfant
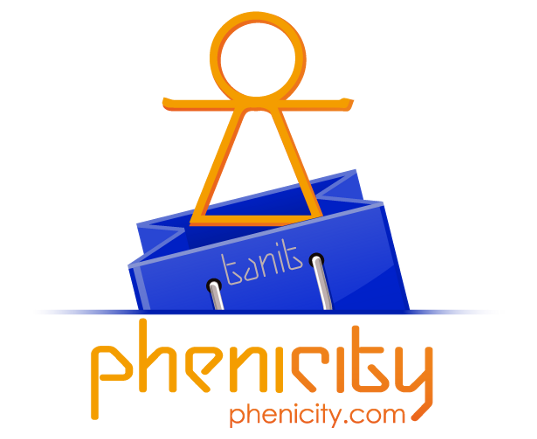
Phénicity.com est Phenicity.info à compter d'Avril
2023

« Les Phéniciens et la Méditerranée
» à l’IMA
Préparation de la grande exposition sur
« Les Phéniciens et la Méditerranée
»
du 1er octobre 2007 au
30 mars 2008

Cliquez pour accéder
à la page de l'IMA
Nouveau président de l’Institut du monde arabe (IMA)
à Paris, Dominique Baudis, qui connaît parfaitement
le Liban, prépare une méga-exposition sur le thème
« Les Phéniciens et la Méditerranée
» qui se déroulera dans les locaux de cette maison
prestigieuse.
Vingt ans déjà que l’Institut du monde arabe
domine le paysage culturel français marquant les diverses
étapes de son existence par des méga-expositions
dont la prochaine aura pour thème « Les Phéniciens
et la Méditerranée ». Pour piloter cette opération,
un connaisseur doublé d’un passionné de la
rive orientale de ce que Michel Chiha appelait
« cette mer intérieure. »
Il s’agit de Dominique Baudis, nouveau président de
l’IMA qui, après de brillants mandats à la
mairie de Toulouse et à la présidence du CSA, ne
cache pas sa joie de retrouver ses premières amours. Cet
Orient si proche dans son appellation et si loin dans le temps
qui l’a attiré comme coopérant au Liban où
on n’oublie pas le présentateur du journal télévisé
et, plus tard, le romancier-chroniqueur des croisades.
Aujourd’hui, Baudis veut remonter le temps, encore une fois
et encore plus loin pour conter d’une autre manière
la prodigieuse épopée phénicienne du premier
millénaire avant l’ère chrétienne.
L’événement est prévu du 1er octobre
2007 au 30 mars 2008.
Avec la collaboration exceptionnelle du Louvre et d’autres
musées et institutions du pourtour méditerranéen
dont, bien entendu, ceux du Liban et de Tunisie.
Cadmos, Europe, Adonis, Byblos, Tyr, Sidon, Carthage et d’autres
noms légendaires. L’alphabet et l’architecture
phéniciens, qui restent encore peu connus, se révéleront
dans leurs mystères et leurs splendeurs.
Dominique Baudis se rendra dans quelques semaines au Liban dans
le cadre des préparatifs de cette exposition.
Il a bien voulu en parler en une sorte d’avant-première.
Avec passion et fierté. Il a également fait part
de ses idées et stratégies sur l’avenir de
l’IMA.
D’abord
un constat et un état des lieux
« L’Institut du monde arabe, affirme M. Baudis, est
une des expressions de la cohésion sociale en France,
puisque c’est là où de nombreux jeunes, issus
de l’immigration en provenance des pays arabes, sentent
qu’ils vivent et qu’ils peuvent continuer de vivre
dans un pays qu’ils reconnaissent, qu’ils valorisent
et dont ils respectent la culture. »
L’ancien maire de Toulouse poursuit en soulignant que l’IMA
est un lieu de dialogue exceptionnel avec le monde arabe, ses
cultures et ses traditions puisqu’il permet la connaissance
de l’autre et même l’apprentissage de sa langue
par la littérature, le cinéma et la découverte
dans toute la plénitude des autres moyens d’expression
du monde arabe.
C’est par conséquent, ajoute le nouveau président
de l’IMA, un lieu de respect mutuel, puisque c’est
une maison qui est placée sous le signe de la diversité
et du respect ; avec un potentiel considérable d’un
million de visiteurs chaque année. »
Des visiteurs fidèles, poursuit M. Baudis, puisqu’ils
soutiennent l’IMA avec une contribution de 50 pour cent
aux recettes ; une contribution bienvenue, puisque l’apport
de certains États n’est pas au niveau espéré.
»
Le nouveau patron de l’IMA reconnaît l’existence,
au sein de cette institution, de rivalités entre Maghrébins
et représentants des pays du Machrek, affirmant à
cet égard que ceci n’est pas le propre de l’IMA,
mais un problème qui concerne le monde arabe. Pour lui,
cette maison (comme il l’appelle) vit sous le signe de
la diversité, puisque le monde arabe et la France y sont
chez eux et aussi puisque le monde arabe lui-même est
divers du fait de ses facteurs géographiques et qui s’étendent
sur plusieurs continents.
« L’IMA est un lieu de rencontre et un élément
fédérateur, puisque son haut conseil comprend
les ambassadeurs de tous les pays arabes », ajoute l’ancien
président du CSA. Il précise que dans la programmation
des événements qui se déroulent dans les
locaux de l’institut, on tient compte des diverses sensibilités
pour renforcer cet élément fédérateur.
Dominique Baudis veut dynamiser, innover, élargir les
domaines d’activité de « sa maison »
de manière à dépasser le cadre des événements
culturels. « Il faut, dit-il, organiser dans la maison
des rencontres touchant les domaines économique, scientifique
ou autres. Il faut aussi recourir au mécénat à
travers des entreprises intéressantes et intéressées.
»
Une orientation bienvenue en tout cas pour l’exposition
sur les Phéniciens dont le budget se chiffre à
1,9 million d’euros avec un budget de mécénat
à hauteur de 750 000 euros.
C’est donc à partir de Beyrouth que Dominique Baudis
entamera, dans quelques semaines, son tour de table franco-méditerranéen
pour assurer la réussite de l’opération Phénicie.
Avec le participation d'Elie Massboungi

L’étude du généticien
Pierre Zalloua fait la lumière sur l’histoire des
Levantins, depuis la Syrie jusqu’à la Palestine:
près de 30 % des Libanais de toutes confessions possèdent
le gène phénicien
par Anne-Marie EL-HAGE
Il est désormais établi que près
de 50 % des Libanais de toutes confessions habitent le Liban
depuis 10 000 ans et qu’environ 30 % de l’ensemble
des Libanais sont bel et bien les descendants des Phéniciens.
Ces hommes de la mer, grands navigateurs et commerçants
ont habité, il y a 4 000 ans, soit bien avant l’apparition
des religions chrétienne et musulmane, le littoral méditerranéen
et notamment les côtes libanaise, syrienne, palestinienne,
tunisienne, espagnole, maltaise et anatolienne. Il est aussi
démontré que les Libanais possèdent principalement
le gène levantin, cananéen ou phénicien
J2, indépendamment de leur appartenance communautaire
et religieuse, même si certaines différences minimes
ou au contraire certaines ressemblances apparaissent d’une
communauté à l’autre, mais aussi d’une
région à une autre. Cette caractéristique
génétique, également retrouvée dans
une grande proportion chez les Cananéens, peuple qui
vivait dans les régions littorales, permet d’assimiler
les Phéniciens aux Cananéens.
C’est à ces conclusions qu’a abouti le généticien
libanais Pierre Zalloua, de la Lebanese American University
(LAU), à l’issue de son étude sur le thème
« Qui étaient les Phéniciens ? ».
Une étude qui apporte désormais une réponse
à la question que se posent de nombreux Libanais depuis
bien longtemps : « Les Libanais sont-ils les descendants
des Phéniciens ? »
Entamée
en 2002 par le docteur Pierre Zalloua, également passionné
d’histoire, en collaboration avec le généticien
et anthropologue américain Spencer Wells, cette étude
menée sur un échantillon de 2 500 personnes au
Levant, dont un important nombre de pêcheurs de Saïda,
Tyr et Jbeil, et près de 3 000 personnes dans d’autres
régions méditerranéennes, avait pour objectif
de confirmer une évidence : celle que les Phéniciens
ont effectivement semé leurs gènes dans les régions
par lesquelles ils sont passés. Cette étude, financée
par la National Geographic Research and Exploration Society,
avait fait l’objet d’une publication dans le National
Geographic Magazine. Elle avait même été
le sujet d’un documentaire télévisé
qui a été diffusé sur la chaîne internationale
National Geographic, après avoir été diffusé
en prime time aux États-Unis.
Deux
grands groupes génétiques
Quant au procédé utilisé par le généticien,
il a consisté, à partir de prises de sang, à
étudier les gènes de l’échantillon,
exclusivement de sexe masculin. Ces gènes ont été
comparés à l’ADN d’échantillons
de dents phéniciennes remontant à près
de 4 000 ans fournis par des archéologues libanais, ainsi
qu’à des échantillons de dents et de peau
de la momie phénicienne King Tabnet (le roi des Phéniciens
de Saïda), qui lui ont été fournis par la
Turquie. Pierre Zalloua rappelle par ailleurs que deux raisons
l’ont poussé à choisir un échantillon
essentiellement masculin : la première explication, scientifique,
est que « le chromosome sexuel masculin, transmis par
l’homme à son fils, ne subit aucun croisement et
ne change pas par mutation aléatoire ». On retrouve
donc ce chromosome dans toute la descendance mâle. La
seconde raison est que « ce sont les hommes qui ont voyagé
et qui ont donc semé leurs gènes dans les pays
où ils se sont installés ».
C’est en identifiant une caractéristique génétique,
« le J2, commune à près de 30 % des Libanais,
mais aussi aux populations levantines, issues d’une partie
de la Syrie et de la Palestine », que Pierre Zalloua a
tiré ses conclusions. « Il est aussi clair et net
que les régions méditerranéennes, notamment
Malte, Chypre, la Sicile et la péninsule Ibérique,
regorgent de populations qui ont des origines levantines et
qui présentent les caractéristiques génétiques
J2 », constate le docteur Zalloua.
En fait, le généticien tient à préciser
qu’« il a été possible de retracer
la présence de deux grands groupes génétiques
qui se sont installés au Liban depuis 10 000 à
18 000 ans environ, mais à 5 000 ans d’écart,
et donc bien avant l’apparition des religions » :
le gène principal étant le J2, caractéristique
cananéenne ou phénicienne. Quant à l’autre
grand groupe génétique, il s’agit du gène
J1. Quoique moins important en nombre que le J2, ce gène
retrace le premier groupe moyen-oriental qui a habité
le littoral levantin et qui est venu du Yémen, de la
Péninsule arabique et de la Mésopotamie (Bilad
ma beyn el-Nahreyn).
Bien plus tard, le Liban sera le lieu de nombreuses invasions
et la population libanaise sera génétiquement
marquée par trois conquêtes, celle des croisés,
qui répandront le gène R1B (de nombreux Libanais
sont blonds aux yeux bleus, notamment à Tripoli et à
Saïda, qui ont directement subi la présence des
croisés), celle des Ottomans et celle des peuples de
la Péninsule arabique, qui répandront le gène
J1, déjà présent au Liban. « Mais
ces influences génétiques n’ont pas réussi
à noyer le génotype phénicien J2, qui demeure
toujours la principale caractéristique génétique
retrouvée parmi la population libanaise », tient
à remarquer le généticien. Il observe d’ailleurs
que « le pourcentage de ce gène atteint 50 % dans
certaines régions, notamment sur le littoral et dans
la montagne de Jbeil ».
Des
similitudes entre les communautés
Pierre Zalloua refuse de donner de plus amples détails,
notamment concernant les différences significatives qu’il
a constatées au niveau de l’existence du gène
phénicien dans les groupes communautaires. Il se contente
de remarquer qu’il existe beaucoup de similitude entre
toutes les communautés. « Mon seul message est
un message de paix qui s’adresse à tous les Libanais,
tient-il à dire. Nos ancêtres ont vécu sur
ce territoire il y a 10 000 à 18 000 ans. Qu’ils
soient devenus par la suite chrétiens, sunnites, chiites,
ou druzes, ils ont tous en commun des origines communes, mais
aussi cet attachement très fort à ce petit morceau
de territoire à l’histoire si compliquée.
La connaissance de leur passé pourrait aujourd’hui
aider les gens à avancer et à s’entendre
», observe-t-il encore, avant d’ajouter : «
Notre patrimoine est très riche. C’est à
travers le Moyen-Orient et le Levant que le monde a été
peuplé. »
Le généticien ne peut cependant s’empêcher
de déplorer « le manque d’intérêt
des Libanais à leur histoire ». En effet, si les
personnes qui font partie de l’échantillonnage ont
participé avec fierté à l’étude,
celle-ci semble avoir été fraîchement accueillie
dans certains milieux confessionnels et politiques. «
Les gens ont peur d’ouvrir des portes qui touchent aux
minorités », observe-t-il. Mais cette réticence
n’empêche pas le généticien de se fixer
de nouveaux objectifs, malgré « le manque de fonds
» et « l’absence de généticiens
spécialisés pour l’assister dans ses recherches
au Liban ». Après avoir finalisé son étude
sur les Phéniciens, qu’il envisage de publier dans
une revue scientifique, il fait le projet d’entamer une
nouvelle étude sur les civilisations arabes, mais aussi
d’« aller sur les traces des Phéniciens »,
par le biais d’un second documentaire.
Dans l’espoir que des considérations politico-confessionnelles
ne viendront pas entraver les travaux scientifiques du chercheur
qui cherche par-dessus tout à prouver que la présence
des populations sur le littoral levantin remonte à des
milliers d’années.

«
Les Cananéens-Phéniciens, peuples et terres »,
de Hareth Boustany
Plongée au cœur d’une civilisation perdue dans
la nuit du temps
En librairie depuis décembre
2007

Installés
à la fin du IIIe millénaire avant J-C sur une
étroite bande côtière s’étendant
du nord de la Palestine au sud de la Syrie, traités de
« barbares, sans culture » par les Grecs, ils sacrifiaient
les enfants en les immolant au nom des dieux ; ils vendaient
des femmes sur le parvis des temples et pratiquaient la prostitution.
Ces hommes étaient nos ancêtres, les géniaux
inventeurs de l’alphabet, les Cananéens-Phéniciens
qui sont aux origines du Liban. En raison de la rareté
de la documentation iconographique et des sources écrites
les concernant, ils restent encore assez « énigmatiques
». Cependant, tous les spécialistes s’accordent
à les définir comme des navigateurs réputés
et des commerçants avisés ayant sans cesse repoussé
plus loin leur horizon et contribué au « brassage
des cultures » entre l’Orient et l’Occident.
Dans son livre « Les Cananéens-Phéniciens,
peuples et terres », paru aux éditions Aleph/ Ad-Da’irat,
l’archéologue-historien, Hareth Boustany, relate
les différents aspects d’une civilisation qui a
laissé son empreinte dans la Méditerranée.
S’appuyant
sur les textes anciens et sur les fragments de la mythologie
récupérés entre autres dans la bibliothèque
d’Ugarit, se référant à la partie
infime de la littérature qui a survécu à
ces peuples, mais aussi sur les résultats des fouilles
archéologiques, Hareth Boustany déroule sur 227
pages illustrées de photographies les origines et le
cadre géographique des « Cananéens-Phéniciens
», les récits de leur expansion coloniale, leurs
rites et institutions politiques, leurs mythes et légendes,
leurs pratiques funéraires, les détails précieux
de leur vie quotidienne, ainsi que leur savoir-faire artisanal
reconnu dans toute l’Antiquité.
Mais c’est tout d’abord en mer que les Phéniciens
se trouvent dans leur élément, déployant
un orgueil et une assurance légendaires. En quête
de métaux, ils arpentent la Méditerranée
occidentale et fondent des comptoirs de commerces et des colonies
dont la célèbre Carthage, symbole éclatant
du rayonnement phénicien. « Semblables en quelque
sorte aux Portugais de la Renaissance, ils rançonnent
implacablement la navigation étrangère, réclament
et défendent le monopole absolu des mers. Quelques ports
seulement sont ouverts au commerce de la concurrence grecque
et étrusque : Palerme, Utique et Carthage. Tout le reste
de la sphère d’influence phénico-punique,
la Péninsule ibérique, la Sardaigne et la Corse,
la côte du Maghreb, est inaccessible (…) ».
Ces patrons de la mer ont aussi excellé en médecine.
« La découverte dans une tombe de 700 crânes
dont trois étaient perforés à la partie
supérieure semble indiquer que l’opération
du trépan était couramment pratiquée à
une époque très reculée (…) Nous avons
aujourd’hui l’assurance que la science médicale
avait atteint en Canaan un stade avancé et relativement
perfectionné, au moins un millénaire avant l’époque
classique, soit au XVIe siècle avant J-C », indique
l’auteur, qui signale d’autre part que la chirurgie
dentaire était également pratiquée : «
On est surpris de constater, par exemple, dans les mâchoires
de beaucoup de crânes phéniciens, des dents plombées
en or, des sutures en filigrane et des râteliers si ingénieusement
travaillés qu’ils défient les plus grands
perfectionnements de l’art dentaire. » Selon Boustany
toujours, « Strabon, le grand géographe grec du
1er siècle avant J-C, raconte que ce sont les Phéniciens
qui s’adonnèrent à l’astronomie et qui
identifièrent les constellations célestes, utiles
à la navigation nocturne. »
Des chapitres sont également consacrés à
la découverte de la pourpre sur laquelle ce peuple avait
fondé une bonne partie de sa puissance économique
; au verre dont l’invention lui fut attribuée et
dont un passage de l’histoire naturelle de Pline (livre
XXXVI) évoque « un bord de mer phénicien,
pas plus grand que cinq cents pas, qui aurait été
pendant plusieurs siècles la seule localité de
l’Antiquité où on fabriquait le verre ».
Adoptant les modèles culturels de leurs clients, l’industrieux
peuple de marchands a fait preuve aussi d’une création
artistique et d’un artisanat raffiné qui donnent
à voir des formes et motifs égyptiens, des sceaux
mésopotamiens, des lions hittites, des stèles
helléniques, des monnaies siciliennes, des masques de
vieux spartiates et des bijoux étrusques.
Se référant, par ailleurs, aux archives cananéennes
d’Ugarit, aux inscriptions des stèles, aux moules
des pâtissiers, mais aussi aux mosaïques représentant
des grives, des gazelles, sangliers, scènes de pêche
ou grappes de raisin, l’auteur donne un aperçu de
la cuisine phénicienne, illustrée également
par un « chaudron avec protomés de serpents et
défilé d’animaux » ! Mais, «
dans les champs ondoyants de blé, d’orge, de froment,
voici fleurir la vigne, l’olivier et les jardins qui donnent
généreusement les fèves, les lentilles
et les pois chiches : ainsi fut la cuisine méditerranéenne
», écrit Hareth Boustany, ajoutant que le vin était
réservé à un usage de luxe, aux rites de
l’hospitalité et à … une invitation
pour une plongée au cœur de Canaan, mentionné
de nombreuses fois dans la Bible comme le pays promis à
Abraham et à sa descendance (Genèse 17, 8 ; cf
. Psaume 105, 11).

Sortie le 17 Septembre 2007 du livre:
"Les Hommes debout, dialogue avec les Phéniciens"

par Georgia Makhlouf
accompagnée par Judith Rothchild
Ce
peuple de passeurs...
Parallèlement à l'exposition de l'Institut
du Monde Arabe, comme pour l'accompagner et la prolonger d'une
réflexion personnelle, paraît aux Editions Al Manar,
le livre de Georgia Makhlouf, intitulé Les hommes debout.
Une interrogation essentielle "autour des Phéniciens"
qui, par questionnements concentriques, éclaire autant
ce peuple de marins que l'auteure elle-même.
De son précédent livre, Georgia Makhlouf a gardé
les éclats et la mémoire.
Mais cette fois, il ne s'agit plus de sonder son histoire personnelle
mais de remonter à l'enfance de notre mémoire
collective, aux sources de notre identité. L'auteure
interroge les Phéniciens pour rétablir ce fil
aussi tenace qu'invisible qui nous lie à ce "peuple
qui avait le mal d'horizon", ce peuple qui "a compris
que le métissage est le creuset d'un monde qu'il faut
sans cesse réinventer". Et chemin faisant, elle
découvre certes les navigateurs intrépides inventeurs
de l'alphabet, mais elle se dévoile en même temps
et accomplit ses vies antérieures, son "identité-pont".
Car dans ce beau texte, tout se passe comme si, à force
de fouiller son héritage, Makhlouf polit son écriture;
ses fragments deviennent limpides, pourpres sur les sables de
Tyr, bleus pour se mêler à l'aventure de la Méditerranée,
blancs à l'assaut des flots, enfourchant le taureau,
à l'image d'Europe séduite par l'exil.
"L'exil et l'écriture, les deux branches de ma généalogie
imaginaire.
Mais il s'agit surtout d'une profession de foi universelle.
A force d'aiguiser sa vision du monde, Makhlouf en arrive, avec
le courage que procure la clarté, à ce formidable
énoncé à l'adresse des "faussaires
de l'histoire": "Car c'est être bien peu phénicien
que d'avoir si peur de l'autre".
Antoine
Boulad, L'Orient le jour
Edition
Al Manar - collection Méditerranées
ISBN 978-2-913896-50-5, 18 euros
|
L'Alphabet
Phénicien proposé en
2004-2005 pour
l'inscription au
Registre
Mémoire du Monde de l'Unesco
  
Les Libanais sont-ils
les descendants des Phéniciens ?

Personne n’a été capable, jusque-là, de donner
une réponse catégorique à cette question pour le moins controversée.
La seule certitude, scientifiquement confirmée aussi bien par
les archéologues que par les historiens, est que les Phéniciens,
ces hommes de la mer, grands navigateurs et commerçants, ont habité
le littoral méditerranéen et notamment les côtes libanaise, syrienne,
palestinienne, tunisienne, espagnole, maltaise et anatolienne.
L’évidence, qui reste toutefois à confirmer, est que les Phéniciens
ont semé leurs gènes dans les régions par lesquelles ils sont
passés. Aujourd’hui, cette grande question refait surface grâce
à une étude génétique, sur le thème « Qui étaient les Phéniciens
? », commencée depuis deux ans par le généticien libanais Pierre
Zalloua, diplômé de la prestigieuse université de Harvard, en
collaboration avec son collègue et ami Spencer Wells, généticien
de population.

Cette étude, financée à hauteur de 37 000 dollars
par la « National Geographic Research and Exploration Society
», a fait l’objet d’un grand reportage dans le numéro d’octobre
dernier de la revue américaine, désormais disponible en français.
Elle a aussi été le sujet d’un documentaire télévisé, qui a été
diffusé en « prime time» aux États-Unis et qui sera bientôt diffusé
sur la chaîne internationale National Geographic.
Elle devrait, une fois terminée et indépendamment des réserves
émises par la communauté archéologique locale qui craint une politisation
de la question, apporter aux Libanais la réponse à leurs questions
sur leurs origines.
Dossier réalisé par Anne-Marie El-Hage pour L'Orient-Le
Jour
|
Les
estampilles de Tyr, précieuses indications sur l’évolution
de l’écriture phénicienne

Figurine représentant le Dieu Bès
Dans cette région qui
a inventé et diffusé le système alphabétique, le bilan de l’épigraphie
phénicienne du Levant demeure désespérément restreint. Mis à part
quelques inscriptions dédicatoires exhumées à Tyr, en 1972, très
peu de documentations datant de l’époque phénicienne ont été mises
au jour. Les raisons de cette carence sont révélées par l’archéologue
Ibrahim Kaoukabani, dans un article intitulé « Les estampilles
phéniciennes de Tyr », paru dans le dernier numéro de la revue
« Archéologie et Histoire du Liban ». Tout d’abord, compte tenu
de la guerre civile, les travaux de fouilles menés sur les grands
sites du Liban « ne sont encore qu’à leur début et n’ont pas atteint,
hormis à Byblos, les couches hellénistiques et celles relatives
à l’âge d’or phénicien (entre le Xe et le Ve siècle avant JC)
», explique Kaoukabani. D’autre part, les écrits découverts jusque-là
sont gravés sur des matières résistantes, comme les statues, les
sarcophages et les stèles, alors que ceux qui sont enregistrés
sur des supports périssables, comme la céramique, le verre et
les parchemins, sont presque perdus, en raison du climat côtier
défavorable à leur conservation. Il faut ajouter à cela le coup
fatal porté à la civilisation phénicienne dès le IVe siècle avant
JC, c’est-à-dire depuis l’avènement d’Alexandre le Grand. Les
Hellènes qui considéraient les Phéniciens comme de sérieux rivaux
ont entrepris la destruction systématique des cités phéniciennes.
Cependant, souligne l’archéologue, « les Grecs ont répandu dans
l’ancien monde le nouvel esprit hellénique fondé à la fois sur
le Beau platonicien et la logique aristotélicienne qui ont aussi
adopté le système alphabétique phénicien pour le diffuser en Occident.
Et l’on sait combien les deux cultures se rapprochent, voire se
confondent, de sorte que les croyances ainsi véhiculées semblent
être bien identiques aussi bien en cosmogonie qu’en mythologie,
quoi que certains noms aient changé d’appellation», a-t-il fait
observer. Toutefois, 160 anses de jarres torsadées, timbrées d’inscriptions
phéniciennes, et quelque 200 autres inscrites en grec, le tout
exhumé en 1972, à Jal el-Bahr (à deux kilomètres au nord de Tyr),
sont des «prémices prometteuses». En effet, cette découverte pourrait
faire partie d’un lot qui permettrait de révéler des informations
précieuses sur les activités commerciales, religieuses, historiques
et culturelles des Phéniciens, mais aussi « des indications sur
l’évolution formelle de l’écriture phénicienne, en particulier
celle de la glyptique ». Ibrahim Kaoukabani signale, par ailleurs,
que la majeure partie des estampilles commence par le terme /Srt/
«tyrienne» pour indiquer sans doute la vraie origine. Ces jarres
destinées à contenir des liquides (vin, huile) ou des denrées,
sont fabriquées et remplies dans des ateliers syriens pour les
exporter par voie maritime aux quatre coins du monde ancien qui
s’étend de l’Égypte «Msrm», au Sud, jusqu’à Rhodes et Chypre,
au Nord. Les estampilles rapportent également une série de noms
concernant les propriétaires. « Les anthroponymes sont généralement
des théophores, tantôt simples, tantôt composés, comprenant un
nom hypocoristique complété par un suffixe nominal ou verbal,
et le recensement de ces noms montre que les deux dieux, Baal
et Milqart, y sont les plus souvent cités», explique Kaoukabani,
mettant l’accent sur l’intérêt historique tout particulier que
comporte la double datation de ces estampilles. «Jusqu’à maintenant,
l’adoption d’une double date dans la cité phénicienne reste très
contestée.

Or le fait qu’un bon nombre de ces estampilles
porte deux ères de datation différentes permet enfin d’élucider
ce problème et de trancher définitivement cette question en admettant
une ère propre au peuple de Tyr, débutant en 274/3 avant JC et
une autre plus récente qui commence en 126/5 avant JC. » On dénombre
aussi quatre exemplaires datés à l’égyptienne, c’est-à-dire que
« des lettres grecques y font fonction des chiffres introduits
par le sigle /L/, ce qui incite à les dater d’après l’ère d’Alexandre,
inaugurée le 1er août en l’an 30 avant JC.» Ces jarres semblent
être importées d’Égypte soit pour satisfaire le marché local,
soit pour les réexporter à l’étranger par l’intermédiaire du commerçant
tyrien. Enfin, compte tenu des relations commerciales déjà établies
entre la Phénicie, notamment Tyr, et le monde méditerranéen, «on
constate que ces rapports étaient à l’origine d’une réelle renaissance
culturelle et artistique née de ce métissage où les influences
grecques et égyptiennes se sont mêlées au substrat phénicien en
vue de l’enrichir»,
souligne encore Kaoukabani.
Le temple
Signalons, enfin, que les estampilles phéniciennes ont été mises
au jour à proximité d’un bâtiment rectangulaire (5,50 m x 3,825
m) dont les fondations sont intactes et les murs, construits en
pierres sableuses couvertes d’enduit blanc, sont en partie démantelés.
Kaoukabani décrit l’intérieur de ce bâtiment qui est divisé transversalement
en deux salles aux dimensions égales. Dans la première salle,
à laquelle on accède par une porte latérale, est érigé un autel
coiffé d’une maçonnerie ayant la forme d’une table équarrie (55
cm x 55 cm) au bord mouluré. Reposant sur des fondations en pierres
de ramassage, le tronc de l’autel est couvert d’enduit ocre rougeâtre,
alors que son couronnement est badigeonné de blanc. Derrière cet
autel, trois rangées de gradins, aujourd’hui détruits à moitié,
ont été aménagées en banquettes sur lesquelles les fidèles déposaient
leurs offrandes en ex-voto. Des panneaux, peints alternativement
de gris, de bleu et d’ocre, décorent les parois à une hauteur
de 76 cm environ. Ils sont délimités au sommet par un galon rouge
ocre dont la largeur ne dépasse pas les 15 cm. Les angles sont,
en outre, dotés de piliers équarris (25 cm x 25 cm) peints en
rouge. Ils jouaient le rôle d’autels secondaires et sont marqués
au sommet par un listel bien prononcé. La seconde salle ressemble
initialement à la première, mais elle a subi ultérieurement un
changement radical pour y aménager un four qui en occupe par son
diamètre de plus de 189 cm toute la superficie. Ce four, qui a
livré une quantité de tessons à glaçure arabe, est daté entre
le VIIIe et le IXe siècle de notre ère.
La porte, qui desservait à l’origine cette salle, est toujours
obstruée par des pierres mêlées aux briques. Elle servait, semble-t-il,
à alimenter le foyer du four en combustibles. Ce temple, qui acquiert
l’aspect d’un sanctuaire à Jal el-Bahr, est entouré d’un mur d’enceinte
(40 m x 27 m) construit selon la technique phénicienne qui consiste
à dresser des piliers bien appareillés, délimitant des travées
remplies de pierres de ramassage mêlées à un moellon fait de chaux
et de sable. Un enduit peint en blanc devait les couvrir à l’extérieur
comme à l’intérieur. L’archéologue relève ensuite que tout près
de ce bâtiment, mais à un niveau supérieur, ont été exhumées des
tombes contenant des squelettes. Mais aussi, les 160 jarres torsadées
et timbrées d’inscriptions phéniciennes ainsi que 200 autres inscrites
en grec.
|

À
la recherche du lien entre les peuples du littoral

Mais cette première étape ne se limite
pas à l’étude des gènes des seuls Libanais. « En effet,
indique le généticien, les gènes de 400 Syriens du littoral,
de 350 Tunisiens, de 250 Maltais, de 100 Palestiniens
(du Liban), d’une cinquantaine de Jordaniens hachémites...
sont aussi en cours d’étude. » Par ailleurs, et pour confirmer
ses résultats par des preuves irréfutables, Pierre Zalloua
entreprend de faire extraire l’ADN de quelques échantillons
de dents phéniciennes, remontant à près de 4 000 ans,
fournies par des archéologues libanais, alors que la Turquie
lui a permis d’utiliser des dents ainsi que des échantillons
de peau de la momie phénicienne King Tabnet (le roi des
Phéniciens de Saïda), transférée en Turquie à l’époque
des Ottomans. Recherche qui est entreprise par un laboratoire
en Allemagne, « le seul au monde à être capable d’extraire
un ADN aussi ancien », précise-t-il. Quant à l’objectif
de cette première étape, il consiste à établir un lien
commun entre les hommes du littoral libanais et les hommes
des pays cités ci-dessus. Lien qui devrait être établi
sitôt trouvé l’haplotype de chaque personne, au terme
des 24 tests approfondis dont fera l’objet chaque échantillon
de sang. Mais pourquoi l’échantillon est-il exclusivement
composé d’hommes ? « Deux raisons majeures nous ont poussé,
à ce stade de l’étude, à privilégier un échantillonnage
exclusivement masculin », explique le chercheur. La première
raison, scientifique, selon le Dr Zalloua, est que le
chromosome sexuel « y » ne subit aucun croisement ou brassage
génétique. En effet, une partie du bagage génétique de
l’homme vient à 100 % de son père et n’est, en aucun cas,
influencé par sa mère. On retrouve donc ce chromosome
dans toute la descendance mâle. Il ne change pas par croisement,
mais peut changer par mutation, même si cette mutation
survient rarement. « Quant à la seconde raison, poursuit
le généticien, elle s’explique par le fait que ce sont
les hommes qui ont semé leurs gènes, car ce sont eux qui
ont voyagé et qui se sont unis aux femmes, dans les pays
où ils se sont rendus. » Certes, les recherches entreprises
par le généticien ne permettront pas simplement de trouver
l’haplotype phénicien, mais aussi de retracer les différentes
ascendances des Libanais. « En effet, explique-t-il, le
Liban a été le lieu de nombreuses invasions, mais il a
été génétiquement marqué par trois grandes conquêtes,
celles des Croisés, des Ottomans et des peuples de la
péninsule arabique ». Aujourd’hui, Pierre Zalloua affirme
avoir déjà les résultats préliminaires de la première
étape de sa recherche. « Je ne suis pas encore en mesure
de tout dévoiler, mais je peux dire que je suis sur la
bonne voie », dit-il. Et de constater des ressemblances
génétiques très importantes entre Libanais de régions
et de religions différentes, notamment entre chiites et
maronites, qui ont, tous deux, fortement subi l’influence
des Croisés. Le généticien précise à ce propos que certaines
familles sont majoritairement composées de blonds aux
yeux bleus. Par ailleurs, il déclare avoir trouvé des
liens surprenants, à un degré très élevé, entre les Libanais
et les Maltais. « Je suis certain que j’arriverai à trouver
un haplotype phénicien, affirme-t-il. J’ai déjà des preuves
palpables de ce que j’avance. Mais il me faut davantage
de temps et davantage de recherches ».
|
Pierre
Zalloua :
« Il est grand temps
de briser les tabous et d’en savoir plus sur les racines
des Libanais. »
 Un généticien passionné
d’histoire et d’archéologie Pierre Zalloua est généticien-chercheur
à l’Hôpital de l’Université américaine de Beyrouth (AUH),
où il exerce depuis un an dans les deux départements de
médecine interne et de gynécologie. Il a obtenu le « fellowship
», titre académique de Harvard, au terme d’une spécialisation
postdoctorale dans le domaine de la génétique, après 12
années d’études dans cette prestigieuse université aux
États-Unis. Parallèlement à l’étude génétique sur les
Phéniciens qu’il conduit actuellement, le Dr Zalloua a
publié une étude scientifique qu’il a menée sur la thalassémie
(maladie qui touche 3% de la population libanaise), alors
qu’il exerçait au Chronic Care Center.
Un généticien passionné
d’histoire et d’archéologie Pierre Zalloua est généticien-chercheur
à l’Hôpital de l’Université américaine de Beyrouth (AUH),
où il exerce depuis un an dans les deux départements de
médecine interne et de gynécologie. Il a obtenu le « fellowship
», titre académique de Harvard, au terme d’une spécialisation
postdoctorale dans le domaine de la génétique, après 12
années d’études dans cette prestigieuse université aux
États-Unis. Parallèlement à l’étude génétique sur les
Phéniciens qu’il conduit actuellement, le Dr Zalloua a
publié une étude scientifique qu’il a menée sur la thalassémie
(maladie qui touche 3% de la population libanaise), alors
qu’il exerçait au Chronic Care Center.
Cette étude lui a notamment permis de retracer les migrations
internes dans le pays.
Pour ce jeune généticien d’une trentaine d’années, passionné
d’histoire et d’archéologie, l’étude génétique qu’il conduit
sur les Phéniciens est aujourd’hui sa priorité et, peut-être
même, le projet de sa carrière.
|

Quelques liens utiles sur
la Phénicie
Notre préféré?:
Phéniciens.com
Comme le disent si bien ses auteurs, Souraya
et Jad Abifarès, se pencher sur les phéniciens
permet de préserver la mémoire tout en consolidant
l'avenir!
mais aussi...
La
Phénicie, pour
tout connaitre des origines du peuple libanais grace à
ce site particulièrement bien documenté.
La
Phénicie, un
autre site personnel qui démontre toute la fascination
qu'elle exerce sur ceux qui respectent le berceau de notre
civilisation.
Tyr,
grand port disparu; le
site sur les recherches des années 1930 de Antoine
Poidebard est un véritable site musée avec
des photos anciennes, aériennes et de plongée
à la recherche du temps et de la gloire passés
de la cité phénicienne.
La
Page des Phéniciens
de l'encyclo Wikipédia |

Cette Page est encore en développement...
|

Ouvrir
le débat et briser les tabous:
prouver que les Libanais,
indépendamment de leur religion,
sont les descendants des Phéniciens

Pierre Zalloua, passionné de génétique,
d’archéologie et d’histoire, est aussi un amoureux du
Liban. C’est cette passion qui a déclenché en lui l’idée,
il y a 4 ans, d’entreprendre une étude sur les Phéniciens.
Son hypothèse de base est la suivante : en étudiant les
gènes des populations actuelles des régions par lesquelles
sont passés les Phéniciens, il est possible de retracer
leur histoire et d’isoler des caractères génétiques (haplotypes)
communs à toutes ces populations. «Le caractère génétique
phénicien existe et je suis à sa recherche, assure le
généticien. Si je le retrouve, aussi bien au Liban, qu’à
Malte, en Tunisie, en Espagne, ou en Anatolie, là où les
Phéniciens ont vécu, je pourrais confirmer qu’il s’agit
de l’haplotype phénicien et je pourrais aussi dire que
les Libanais chez lesquels on le retrouve, et indépendamment
de leur religion, sont bien les descendants des Phéniciens
». Mais comment Pierre Zalloua a-t-il procédé dans sa
recherche ? « Cette étude génétique nécessite d’être conduite
en plusieurs étapes, précise le chercheur. Dans une première
phase, à partir d’une prise de sang, nous avons étudié
les gènes d’un échantillon de 2 000 Libanais de sexe masculin
issus de toutes les régions du pays, du littoral comme
de la montagne. Nous avons particulièrement veillé à inclure
à ce niveau un nombre important de pêcheurs des villes
historiques de Saïda, Tyr et Jbeil, exerçant le métier
de père en fils, et ce depuis des générations. » Trouver
l’échantillon adéquat a été une simple formalité pour
le généticien. En effet, sitôt informés de l’étude, des
dizaines de pêcheurs, toutes confessions confondues, ont
afflué dans les cafés portuaires, pour se prêter aux tests
sanguins. « Travailler avec des hommes qui expriment avec
une telle fierté leur sentiment d’appartenance au Liban
était très agréable », observe à ce propos Pierre Zalloua.

Un tabou à briser
En effet, poursuivant l’analyse des données qu’il
a jusque-là récoltées, et dans l’attente de voir la première
étape de son étude publiée dans une revue scientifique,
Pierre Zalloua envisage, dans une seconde étape, d’élargir
son échantillon au Liban, au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Un échantillon qui serait composé de 5 000 Libanais
des deux sexes et de 1 000 personnes de chacun des pays
concernés. « Nous aurons alors la possibilité d’établir
des études comparatives avec celles entreprises par d’autres
chercheurs en Anatolie et en Espagne », indique-t-il.
Mais cette seconde étape nécessite des fonds bien plus
importants que ceux qui ont été débloqués jusque-là par
la National Geographic Research and Exploration Society.
En effet, malgré les promesses de cette dernière, ainsi
que l’appui moral et scientifique de l’Université de Harvard,
avec laquelle le généticien collabore régulièrement, les
fonds nécessaires au démarrage de la seconde partie de
l’étude manquent. « Je voudrais tellement que l’État libanais
réalise que cette étude est un projet national », dit-il.
Mais au-delà du bon vouloir d’un État d’aider ou non dans
son étude un chercheur confirmé, au-delà de la volonté
de ce même État de qualifier un projet de national, c’est
un véritable débat à consonance politico-confessionnelle
que l’étude de Pierre Zalloua ouvre aujourd’hui. Les Libanais
sont-ils les descendants des Phéniciens ? Quels Libanais
sont-ils les descendants des Phéniciens ? Quelle place
occupe l’influence arabe dans leurs racines ? « Il est
grand temps d’ouvrir enfin ce débat, pour briser le tabou
relatif aux racines phéniciennes des Libanais », répond
le chercheur, insistant sur le fait que l’haplotype phénicien
remonte à 4000 ans, bien avant le christianisme et l’islam.
« Ouvrir ce débat est d’ailleurs un des objectifs de l’étude
», dit-il. Mais pour l’instant, et malgré l’intérêt scientifique
international pour le sujet, les instances locales ne
semblent pas prêtes à ouvrir le débat, pas plus qu’elles
ne cherchent à faciliter la tâche au généticien. En effet,
la Direction générale des antiquités (DGA) n’a pas jugé
bon de mettre à la disposition du chercheur les échantillons
de dents ou d’ossements dont elle dispose, qui lui sont
nécessaires pour pousser son étude plus loin. Pierre Zalloua
devra se suffire, pour le moment, des échantillons prélevés
sur la momie phénicienne en Turquie, ainsi que des 4 échantillons
de dents qui lui ont été fournis par des archéologues,
dans le cadre de leurs fouilles.
|
Bibliographie
phénicienne...

illustration: couverture du livre,
"Les Phéniciens, Aux origines du Liban"
Eric Gubel & F.Briquel-Chatonnet
Gallimard-1999
|
Le
seul matériel disponible est inadéquat et non répertorié,
selon la DGA
Appui réservé dans le milieu archéologique local
L’étude scientifique
entreprise par le généticien Pierre Zalloua semble avoir
reçu un accueil mitigé dans le milieu archéologique local.
Et pourtant, la collaboration des archéologues, pourvoyeurs
potentiels en matériel archéologique remontant à l’époque
phénicienne (dents, ossements, squelettes, fragments de
peau de momies phéniciennes), pourrait permettre au chercheur
de certifier irrévocablement ses résultats. Le seul matériel
archéologique qu’il a pu se procurer s’est jusque-là chiffré
à 4 dents phéniciennes, fournies par un archéologue, en
plus de dents et de fragments de peau d’une momie phénicienne
mis à sa disposition par la Turquie pour sa recherche.
Quant au matériel archéologique dont dispose la Direction
générale des antiquités (DGA), le Dr Zalloua n’y a pas
eu accès. Le directeur de la DGA, Frédéric Husseini, explique
les raisons de sa réticence à mettre des objets phéniciens
à la disposition du généticien. « Nous ne disposons ni
de dents ni d’ossements phéniciens, nous avons surtout
des objets, genre poteries et vases, assure M. Husseini.
C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas eu la possibilité
de donner le matériel archéologique nécessaire au docteur
Zalloua. » Et le directeur de la DGA d’expliquer que les
objets mis au jour lors de fouilles relèvent généralement
de la responsabilité scientifique des archéologues chargés
des chantiers de fouilles de la DGA. « Si le généticien
s’est vu remettre des dents phéniciennes de la part d’un
archéologue, ce dernier est seul responsable de son acte
», poursuit-il, ajoutant qu’il n’y a pas eu d’interdiction
de la DGA à ce niveau. Quant aux dents anciennes dont
dispose la DGA et qui sont entassées dans des caisses
dans les sous-sols du Musée national, «elles sont hors
contexte», observe Frédéric Husseini. Autrement dit, la
DGA ne semble pas les avoir répertoriées ou même savoir
à quelle époque elles remontent. «Je suis d’ailleurs convaincu
que tous les objets et les restes dont on dispose ne seraient
d’aucune utilité pour l’étude du Dr Zalloua », estime
Frédéric Husseini, concluant que ce manque de collaboration
n’est absolument pas de la mauvaise volonté. Confirmant
les propos de M. Husseini, la conservatrice du Musée national,
Suzy Hakimian, affirme que tout le matériel dont dispose
la direction est carbonisé, contaminé ou alors couvert
de poussière et qu’il ne peut pas être utile au chercheur.
« Nous avons été sollicités par le Dr Zalloua qui voulait
se procurer des dents de l’époque phénicienne, mais nous
lui avons conseillé de se procurer ce matériel de nouveaux
chantiers de fouilles », explique-t-elle. Mais au-delà
de l’incapacité physique de la DGA d’aider le professeur-assistant
Zalloua dans sa recherche, Mme Hakimian ne cache pas sa
crainte des connotations politiques de cette étude. «
J’ai bien peur que l’archéologie soit utilisée politiquement
et qu’elle ne serve pas uniquement la science, confie-t-elle.
J’ai d’ailleurs fait part de mes craintes au généticien
et de la nécessité pour lui de se fixer des garde-fous
». De toute manière, indépendamment de l’avis personnel
de chacun concernant la finalité de l’étude génétique
sur les Phéniciens, indépendamment aussi du fait que la
génétique se base sur la science et que l’archéologie
est fondée sur les écrits et les objets mis au jour par
les fouilles, la DGA laisse entrevoir une possibilité
de collaboration future avec le Dr Zalloua, « mais en
fonction des moyens et des disponibilités ».

Confirmer ce que les historiens et archéologues pressentaient
Pour l’historien Hareth Boustany, qui a effectué des recherches
sur la relation des Libanais avec les Phéniciens, l’étude
génétique menée par le docteur Zalloua ne risque en aucun
cas de créer une polémique.
« C’est une étude basée sur l’ADN, dit-il, qui cherche
à prouver qu’une partie de la population libanaise a des
gènes phéniciens. Une étude qui viendrait confirmer ce
que les archéologues et les historiens pressentaient déjà.
» « D’ailleurs, précise-t-il, le docteur Zalloua, coqueluche
du monde scientifique, travaille avec des laboratoires
de renommée internationale et a déjà obtenu des preuves
scientifiques confirmant son hypothèse. » En fait, M.
Boustany lie la thalassémie, maladie de sang, aux Phéniciens.
La thalassémie ayant été, d’après lui, une maladie fréquente
chez les Phéniciens. Elle aurait même été baptisée « maladie
des Phéniciens » par les Européens.
« Cette maladie existait à Malte, en Sardaigne, en Espagne
et sur les côtes syrienne, palestinienne, libanaise, tunisienne,
marocaine, et peut-être même sur la côte libyenne », estime
Hareth Boustany. Aujourd’hui, elle touche 3 % de la population
libanaise et « sur 100 cas étudiés par le Chronic Care
Center, qui traite les cas de thalassémie au Liban, 82
cas sont de confession musulmane », indique-t-il. Par
ailleurs, poursuit l’historien, le Liban et la Syrie ne
se sont jamais vidés de leurs habitants, malgré les différentes
conquêtes. Il y a eu, au fil des siècles, une continuité
d’occupation du sol par ses habitants, depuis la civilisation
cananéenne, au IVe siècle avant J-C et jusqu’à nos jours.
Et Hareth Boustany d’expliquer que les Cananéens et les
Phéniciens peuvent être considérés comme étant un même
peuple. Ce sont d’ailleurs les Grecs qui leur ont donné
cette appellation de « Phoinikou », qui signifiait « les
hommes rouges », probablement à cause de la pourpre qu’ils
fabriquaient et dont ils faisaient le commerce sur les
côtes. Eux se faisaient plutôt appeler Sidoniens, Tyriens,
Bérytiens, selon la cité de laquelle ils venaient.
|
Vos réactions?

email/courriel:

|
 «
Byblos à travers les âges », cru 2004 revu et complété
«
Byblos à travers les âges », cru 2004 revu et complété
par Nina Jidéjian

Figurine en terre cuite aujoud'hui disparue,
représentant un notable de l’âge du bronze ancien
Byblos à travers les âges est une longue histoire,
si longue que le début se perd dans la nuit des temps. Mais «
Nina Jidéjian a un don de recherche patiente et un talent de présentation
» qui lui permettent d’« extraire et d’ordonner les faits de base
qui marquent le cours des évènements et ceux moins importants
mais évocateurs du détail pittoresque qui éveillera l’attention
», notait Maurice Dunand dans la préface de la première édition
parue en 1968, et dont le texte est repris pour le cru 2004, revu
et complété. L’éminent archéologue André Parrot estime quant à
lui que du fait de ses recherches ardues, « Nina Jidéjian a pu
écrire une grande fresque historique et une synthèse où la vie
de la “ sainte Byblos ” est parfaitement évoquée ». Rappelons
que l’idée du livre remonte aux années universitaires de l’auteur.
Pour préparer sa thèse d’histoire ancienne, Nina Jidéjian s’est
constamment référée aux rapports de Pierre Montet et Maurice Dunand
qui ont entrepris les fouilles de Byblos. « Il m’a semblé qu’il
ne serait pas sans intérêt de rassembler tout cela et de coordonner
les conclusions des découvertes archéologiques avec les inscriptions
et les textes anciens, explique l’auteur. Les quelques exposés
historiques qu’on y lira sur le Proche-Orient ont pour seul but
d’éclairer les périodes pauvrement représentées au point de vue
archéologique. En outre, j’expose les principales thèses de savants
qui ne sont pas d’accord sur tel ou tel point. »
Byblos à travers les âges, nouvelle édition, a été traduit
en français par Denise Halard-Jidéjian en collaboration avec le
R.P. René Lavant, s.j. L’ouvrage déroule 302 pages émaillées de
100 planches en noir et blanc et 36 en couleurs empruntées aux
collections du Musée national de Beyrouth, de l’Institut du monde
arabe (Paris), du musée du Louvre, du ministère libanais du Tourisme,
et une magnifique vue aérienne des temples prise par Raïf Nassif,
en 1968. Le livre reproduit pour la première fois des clichés
de figurines en terre cuite qui ornaient autrefois les vitrines
du Musée national de Beyrouth.
« Pour les soustraire au pillage de la guerre, ces pièces superbes
avaient été emmurées dans des chapes de béton et placées dans
les sous-sols du musée, mais beaucoup d’entre elles ont été définitivement
endommagées par l’humidité de la nappe phréatique. » Il ne reste
plus d’elles que des photographies souvenirs représentant, pour
ne citer que quelques-unes, deux agriculteurs avec leurs bovins
(IIIe millénaire), un fermier portant une coiffe ressemblant à
s’y méprendre à une « labbadé », un notable de l’âge du bronze
ancien ou encore un dignitaire avec sa haute coiffe conique retenue
par une lanière sous le menton, deux autels en terre cuite et
des sculptures d’animaux, dont une colombe vieille de cinq mille
ans.
Des faits divers
Revêtant son habit de conteur, Nina Jidéjian explore les vestiges,
les légendes et les richesses de ce petit port néolithique devenu
un important centre de commerce entretenant des relations avec
la Mésopotamie, le monde égéen et l’Égypte à qui il fournissait
le bois de cèdre pour les travaux de construction et les résines
indispensables à l’accomplissement des rites funéraires. Ses habitants,
réputés comme constructeurs de vaisseaux et comme tailleurs de
pierre, érigent le premier temple en Phénicie : celui de Baalat-Gebal,
la Dame de Byblos, qui a vu défiler les conquérants assyriens,
babyloniens, perses, grecs et romains, époque à laquelle la ville
devint le centre du culte d’Adonis. L’auteur fait aussi une petite
halte au cœur de la ville médiévale où « Saladin ordonne la construction
de la mosquée Sultan Abdel Majid, sur la place centrale, face
au château des Croisés ». Exploitant abondamment les inscriptions,
les récits bibliques, les textes orientaux de Pritchard et un
éventail de documents et rapports scientifiques, Nina Jidéjian
expose l’« essentiel des événements du passé » et signe une synthèse
de « l’état actuel de nos connaissances ». Au fil des pages, elle
relate les cultes de Byblos, les mythes, les mosaïques, les monnaies,
le déboisement de la montagne et met l’accent sur la « remarquable
habileté des artisans ». Elle décrit, avec maints détails pittoresques,
les objets et statues antiques dont celle de la déesse de la santé,
Hygeia, qui bascule de son socle et se casse au niveau du cou
lors du séisme du 16 juillet 555. La tête exhumée à une distance
du corps est recollée par les archéologues ; mais au cours des
événements de 1976-1990, un obus tombé près de la statue sanctionne
à nouveau la tête. Remise sur pied, Hygeia est aujourd’hui exposée
au Musée national de Beyrouth. Nina Jidéjian souligne également
l’importance de l’inscription gravée sur le couvercle du sarcophage
d’Ahiram, qui représente la forme la plus ancienne de l’alphabet
phénicien découvert jusqu’à ce jour et qui est traduite comme
suit : « Sarcophage qu’a fait Ittobaal, fils d’Ahiram roi de Gebal
(Byblos), pour Ahiram son père, comme demeure dans l’éternité.
Et si un roi parmi les rois, gouverneur parmi les gouverneurs,
dresse le camp contre Gebal et découvre ce sarcophage, le sceptre
de son pouvoir sera brisé, le trône de son roi se renversera et
la destruction fondra sur Gebal.
Quant à lui (le profanateur), son inscription s’effacera . »
Tout un chapitre sur l'alphabet phénicien
Le dernier chapitre est consacré à la naissance
et la diffusion de l’alphabet phénicien. « Hérodote, “ père de
l’histoire ” écrit que c’est le phénicien Cadmos et ses compagnons
qui ont introduit l’écriture en Grèce (Histoires 5.58). La formation
des lettres utilisées par les Grecs est si semblable, dans tous
les détails, aux alphabets sémitiques et phéniciens des IXe et
VIIIe siècles avant J-C, qu’elle est sûrement dérivée de l’écriture
nord-sémitique. Une comparaison entre les formes des lettres et
les mots qui les désignent (alpha, bêta, gamma, etc.) qui ne signifient
rien en grec mais qui sont descriptives en langue sémitique, confirme
cette théorie », indique Nina Jidéjian, ajoutant que « aleph désignant
la tête d’un bovin, bethe une maison, gimel un chameau ne laissent
plus de doute quant à la véracité de cette tradition. Hérodote
note que les Grecs se réfèrent à leurs lettres en les appelant
phoinikia grammata (caractères phéniciens), le plus ancien nom
de l’alphabet, preuve de son origine phénicienne . » |
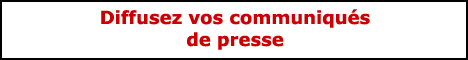
|
Liban
: Le miracle de Byblos
Ce sont les conflits religieux et les divisions
communautaires qui ont ravagé le pays. Après le départ des troupes
syriennes, les Libanais parviendront-ils à chasser leurs propres
démons ? Liban : Le miracle deByblos A 50 kilomètres au nord de
Beyrouth, sur la route de Tripoli, s’étale la ville côtière de
Jbeil, l’antique Byblos, fondée il y a sept mille ans par les
Grecs. La cité est bien connue des touristes pour ses sites archéologiques,
la cathédrale Saint-Jean-Marc, construite au xiie siècle par les
croisés, et ses restaurants de poisson. On ignore en revanche
que dans cette ville et aux alentours, les chrétiens et les musulmans
ne se sont jamais combattus durant les quinze années de la terrible
guerre civile (1975-1990) qui a ravagé le Liban. C’est même au
cours du conflit que Jbeil s’est étendue – le district compte
aujourd’hui 45 000 habitants – accueillant des entreprises qui
ne pouvaient plus travailler à Beyrouth et des Libanais aisés,
chrétiens et musulmans, fuyant les combats. On ne sait par quel
miracle, Byblos n’eut pas à souffrir des affres de la guerre,
ni de l’occupation syrienne. Petit, râblé, un cigare aux lèvres,
Gino Kallab, 60 ans, président de l’agglomération depuis un an,
explique comme une évidence pourquoi sa région a échappé à la
tuerie: «Nous avons toujours vécu en bonne intelligence. La mentalité
des habitants d’ici est différente: c’est comme ça. Nous vivons
du tourisme et du commerce. Les gens sont habitués les uns aux
autres.» Dans ce pays longtemps déchiré où la division communautaire
et religieuse est inscrite dans la Constitution, il n’est pourtant
pas fréquent de trouver réunis dans un même projet des chrétiens
et des musulmans. Byblos, de ce point de vue, n’échappe pas totalement
à la règle. Les partisans du général Aoun, revenu de son exil
parisien en «libérateur», et les Forces libanaises de Samir Geagea
– un des responsables des massacres des camps palestiniens de
Sabra et Chatila en 1982, qui devrait bientôt sortir de prison
où l’avait expédié feu Rafic Hariri, alors Premier ministre –
tiennent le haut du pavé.
Mais ici, ce n’est pas Beyrouth: pas de banderoles souhaitant
la bienvenue à Michel Aoun; pas de cortèges de voitures avec drapeaux
au vent des Forces libanaises, réclamant la libération de leur
chef. Idem du côté musulman, majoritairement chiite, où les sympathisants
du Hezbollah se montrent assez discrets. D’ailleurs, à Byblos,
la campagne pour les élections législatives, qui débuteront le
29 mai à Beyrouth, suscite davantage de méfiance que d’enthousiasme.
Publicité «Maintenant que les Syriens sont partis, ils vont commencer
à se battre entre eux», affirme Rachid, 54 ans, commerçant, qui
ne lit pas la presse et avoue ne plus s’intéresser à la politique.
Cette prédiction est déjà une réalité. La fitna, la discorde,
a fait imploser le camp antisyrien qui avait pourtant rassemblé
des dizaines de milliers de Libanais de toutes les confessions,
après l’assassinat de Rafic Hariri il y a trois mois. Ruptures
étonnantes, alliances improbables, réconciliations étranges: rien
ne va plus aujourd’hui au sein de cette opposition, minée par
les ambitions personnelles. Ainsi, le général Aoun tire à boulets
rouges sur la figure de proue de l’intifada pacifique, le leader
druze Walid Joumblatt, qu’il accuse de changer d’avis tous les
jours. Solange Gemayel, la veuve de l’ancien président de la République
Béchir Gemayel, lui aussi mort assassiné, en 1982, s’est inscrite
sur la liste de Saad Hariri, fils de l’ancien Premier ministre,
pour être certaine d’être élue députée de Beyrouth. Depuis sa
cellule, Samir Geagea a amorcé un rapprochement avec son ennemi
d’hier, Walid Joumblatt. Quant à Bahia Hariri, la sœur du martyr,
que les observateurs occidentaux voyaient comme la future tête
de liste d’une opposition unifiée, elle a décidé de se présenter,
à titre individuel, dans la ville de Saïda (Liban-Sud). La politique
au Liban continue de ressembler à une charge notariale où le fils,
la fille, le frère ou la veuve succède au père. «C’est la valse
des pantins», écrit, ulcéré, l’éditorialiste Ziyad Makhoul, dans
le quotidien «l’Orient-le Jour.» Monique Zheb, 32 ans, pédiatre,
est membre du conseil municipal de Jbeil. Enfant pendant la guerre,
elle n’a aucun souvenir, si ce n’est le canon qui tonnait au loin.
«Ce que je souhaite pour mon pays, dit-elle, c’est la fin du communautarisme
et du confessionnalisme.
L’exemple de Byblos doit être généralisé, pour qu’un jour
les gens disent: je suis libanais d’abord. Après tout, peut-être
que la zizanie actuelle dans les rangs de l’opposition est une
chance, car elle transcende les clivages religieux.» Cette nouvelle
petite musique commence aussi à se faire entendre, parmi les musulmans
de la ville. Issam Awwad, 52 ans, comptable dans une grande société
de traitement de l’eau, a inscrit ses enfants dans une école chrétienne
de Jbeil. «Il faut commencer par l’école, si on veut un jour vivre
dans une société mixte», assure-t-il. Sa fille Hanane, 17 ans,
prépare le bac philo. Elle parle couramment le français et l’anglais:
«A Byblos, tous mes amis sont chrétiens. Je n’ai aucun problème.
Mais normalement, je ne devrais pas avoir à dire que mes amis
sont chrétiens. Un ami est un ami, non? Nous sommes encore prisonniers
de notre histoire.» A une demi-heure de Jbeil, de nombreux villages
constellent le Mont-Liban. Certains sont fixés sur les cimes,
d’autres, cramponnés à la roche, semblent prêts à glisser sur
les pentes très inclinées, d’autres enfin s’étendent à leur aise
dans les vallées. Et un peu partout, des couvents maronites et
des mosquées. Presque tous les couvents occupent des points culminants,
comme celui de Saint-Charbel (1 200 mètres) qu’on voit à plusieurs
kilomètres à la ronde. Ici, chose rare dans la montagne libanaise,
les cloches qui sonnent et l’appel du muezzin ont toujours résonné
en harmonie. Les maronites sont largement majoritaires mais, dans
plusieurs villages, les populations sont mêlées. Depuis la terrasse
de l’église de Toulzïa, à 900 mètres d’altitude, la vue sur la
vallée est imprenable. Le père Marroun Ghalios, 60 ans, «abouna»
(«notre père»), comme l’appellent aussi bien ses ouailles que
les villageois musulmans, est persuadé que seul un miracle a épargné
la région de la folie des hommes: «Nous avons toujours vécu ensemble,
depuis les temps anciens. D’ailleurs, trois familles musulmanes
vivent au village. Pendant la guerre, je rencontrais souvent l’imam
de Hagela, le village voisin. Quand il y avait un décès ici, les
musulmans venaient pour les funérailles; nous faisions de même.
Et l’été, nous préparions les grains pour l’hiver ensemble, se
souvient-il. On a toujours vécu de façon indépendante, cela nous
a peut-être préservés.» Selon une légende, un ermite, abouna Makhlouf
Charbel, qui vécut au xixe siècle dans le village d’Annaya où
se dresse aujourd’hui le couvent qui abrite son mausolée, avait
le don d’accomplir des miracles auprès des malades. Des villageois
chrétiens et musulmans racontent qu’en 1950 encore un prisonnier
musulman atteint de cécité à l’œil gauche, d’un ulcère à l’estomac
et d’arthrite chronique fut guéri après s’être aspergé d’eau bénite
rapportée d’Annaya. La croyance demeure si présente que de nombreux
musulmans des villages alentour continuent de se rendre chaque
année en pèlerinage au couvent de Saint-Charbel. Est-ce dans le
syncrétisme que réside la recette de la cohabitation sereine des
montagnards du district de Jbeil?
Pour Emile, 26 ans, un étudiant originaire de la région qui prépare
un doctorat d’histoire à la faculté Saint-Joseph-de-Beyrouth,
«cette croyance est fondamentale. Elle soude les villageois comme
une tradition commune. Et peu importe si les miracles sont réels
ou non, l’important, c’est qu’ils y croient ensemble». Une autre
thèse est avancée par le moukhtar (maire) du village musulman
d’Almat, Haïdar Ahmed, 65 ans: «Nos villages ne sont peuplés que
d’enfants du pays. Il n’y a pas d’étrangers; la terre se transmet
de génération en génération. Pendant la guerre civile, les miliciens
chrétiens, qui érigeaient des barrages sur la route de Beyrouth
et de Tripoli, n’étaient pas de chez nous. Ils venaient de la
capitale. Seule une poignée de chrétiens de la région se sont
enrôlés dans les milices pour combattre à Beyrouth.» Quant aux
villageois musulmans, aux dires de tous, pas un seul ne serait
parti pour se battre. Mustapha Haddad, 54 ans, était chauffeur
de taxi pendant les années de guerre. A plusieurs reprises, il
a failli se faire tuer par les miliciens chrétiens, sur la route
Beyrouth-Jbeil. «Quand on est jeune, on est inconscient du danger,
reconnaît l’ancien chauffeur. Une fois, c’était en 1980, je transportais
un homme d’affaires allemand, que j’avais pris à Achrafieh, le
quartier chrétien de Beyrouth. Je devais conduire ce client au
port de Jounieh, sur la route de Byblos. A peine avions- nous
parcouru un kilomètre qu’un barrage des Kataëb (les phalanges)
nous a forcés à stopper. Le chef m’a fait descendre, un autre
homme a ouvert un grand livre sur lequel figurait une liste de
noms de musulmans. Comme le mien n’y était pas, ils m’ont laissé
partir.» Musulman, chrétien, chacun a une anecdote. Rafic Lahout,
42 ans, maronite, père de six enfants, travaille comme peintre
en bâtiment, habite le village de Toulzïa. Au début de la guerre,
il avait 12 ans. «Je n’ai pas eu de jeunesse, nous vivions reclus
au village mais nous n’avons pas souffert comme les autres. En
1982, j’ai été sollicité par des miliciens pour m’enrôler; j’ai
refusé. Alors on m’a demandé de provoquer mes voisins musulmans.
Je suis allé trouver mon grand-père, il est allé voir ces miliciens
pour leur dire de ne pas toucher les musulmans, sinon ça allait
barder.» Aujourd’hui Rafic rêve, lui aussi, d’un Liban qui serait
débarrassé du confessionnalisme: «Je suis croyant, mais je pense
que la religion doit rester à l’église et à la mosquée. Sinon,
nous n’avancerons jamais.»
Selon les statistiques, aucune confession ne dépasse le tiers
de l’ensemble de la population libanaise. Pourtant, les chrétiens
sont persuadés que les musulmans sont les plus nombreux. Ce qui
est à la fois vrai et faux en même temps. Car les musulmans se
répartissent entre sunnites et chiites. Et leurs intérêts sont
le plus souvent divergents. De plus, la chute de la démographie
frappe toutes les composantes du pays, comme le montrent plusieurs
enquêtes récentes. Mais ce sentiment de former une minorité menacée
perdure, et engendre des peurs irraisonnées dans le camp chrétien.
Tous les observateurs de la vie politique libanaise estiment qu’une
laïcité à la française n’aurait aucune chance de s’imposer au
Liban dans un proche avenir. Ils croient en revanche possible
une évolution vers une société progressivement sécularisée. Pour
Samir Kassir, politologue et éditorialiste du quotidien «An-Nahar»,
le confessionnalisme n’est pas près de s’éteindre:«On ne change
pas les mœurs politiques en un coup de baguette magique. Le peuple
libanais a obtenu une première victoire: le départ de l’armée
syrienne. Il faut espérer qu’un jour les centaines de milliers
de gens qui sont descendus dans la rue recommencent pour la démocratie
et la fin du communautarisme.» Ce matin, au village d’Almat, Joseph,
le conducteur de bulldozer, est venu aider son ami Mustapha, l’ancien
chauffeur de taxi, à égaliser un terrain accidenté et argileux.
C’est à la dynamite qu’ils ont eu raison de cette terre ingrate.
La déconfessionnalisation, ils la vivent depuis toujours.
Farid
Aichoune
|
|