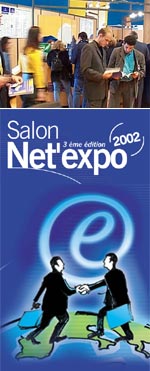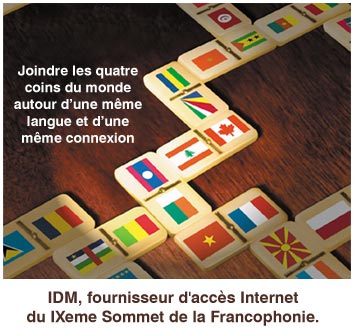|

Retour à
la page d'accueil
Le
regard économique
de Libanvision.com


Présence française au Liban:
Changer
en 2012 ou assumer son déclin:
un enjeu véritable pour la France au Liban
LBV
Août 2011-
Le déclin de la France au Liban est-il irreversible?
La question peut paraitre cruelle et sinistre mais il faut
bien dire que les 5 années qui viennent de s'écouler
ne prête guère à l'optimisme. Si la
guerre de l'été 2006 a mis à mal l'élan
des relations entre le Liban et ses principaux partenaires,
on ne peut pas dire que la France ait été
capable de rebondir suite aux évènements.
Et ce n'est sans doute pas l'issue de l'élection
présidentielle de 2007 qui a favorisé l'amorce
de cette tendance négative.
Durant ce quinquennat, force est de constater que la relation
franco-libanaise a été banalisée au
plus haut niveau, l'exécutif français semblant
plus "agile" à coopérer en milieu
trouble pour tirer quelques ficelles à titre confidentiel
qu'au grand jour dans l'interêt supérieur des
relations séculaires entre les deux peuples...
Sur le plan culturel, on se demande bien ou en serait la
coopération sans la ténacité de quelques
fonctionnaires ultra-motivés et l'engagement indéfectible
de certains libanais.
Ce propos s'illustrent le mieux dans le mode de pérennisation
du salon du livre de Beyrouth désormais piloté
par les libraires libanais. Les coupes sombres dans les
budgets du ministère des affaires étrangères
n'ont pas épargné les allocations financières
et humaines au niveau de la coopération culturelle
de fond ou évènementielle au Liban ou le système
D supplante trop souvent la mise en oeuvre d'une stratégie
définie et efficace.
Il ne suffit pas de s'enorgueillir d'une nouvelle ambassade,
encore faut-il se donner d'autres moyens que la seule bonne
volonté des acteurs locaux pour en être digne.
La cause réelle de cette évolution négative
est sans doute le manque d'implication et d'implusion élyséennes
dans ce domaine.
Qu'il parait lointain le temps ou l'on respirait ce lien
fraternel entre la France et le Liban au plus haut sommet
de l'Etat comme dans les rues de Beyrouth.
Dès 2005, nous prédisions le net recul des
relations économiques entre la France et le Liban.
les représentants français se targuaient d'être
à la lutte avec l'Italie pour occuper le rang de
premier partenaire commercial du Liban.
Aujourd'hui au coeur de l'été 2011, les
statistiques commerciales
décevantes du mois de Juin sont tombées:
la France occupe désormais la 4ème place,
nettement distancée par l'Italie (7,3 millions de
$) l'Allemagne (4,4 millions) et même la Chine (3
millions).
Il serait bien injuste de trouver quelque bouc-émissaire
local que ce soit, nous préférons voir dans
ce constat, l'illustration de l'affablissement général
de la France qui ne semble même plus capable de défendre
ses bastions.
Il faut dire que le pétrole Lybien est pour certains
beaucoup plus excitant que la complexité ou la subtilité
libanaise.
L'histoire de France ne saurait sacrifier plus longtemps
la préciosité de son lien avec le Liban. La
première étape de sa nécessaire reconstruction
serait probablement un changement de locataire à
l'Elysée avec une certaine idée du Liban et
qui ne craint pas de passer une nuit à Beyrouth!
JM
Druart
Bilan et perspectives mitigés
LBV, Janvier 2005- L'année
2004 demeurera une année contrastée sur le
plan de la présence économique française
au Liban.
Comment ne pas en effet commencer par souligner le choc
constitué par le retrait de la filiale de France
Télécom et du réseau Cellis au terme
d'une procédure d'appel d'offre interminable et à
rebondissements.
Cet évènement a été largement
minimisé mais n'en demeure pas moins hautement symbolique
quelqu'en soient les raisons.
On pourra certes se consoler grâce à la progression
de la part de marché des marques automobiles françaises
avec la belle percée de Peugeot en tête des
ventes du dernier trimestre 2004.
La fin de l'année fut aussi marquée par l'inauguration
du premier hypermarché libanais aux couleurs du distributeur
français Casino avec l'enseigne "Géant".
L'année 2004 fut églement marquée par
l'opération
"La France Expose" au coeur du centre-ville de
Beyrouth, patronnée par l'Ambassade de France. Si
celle-ci étala la visibilité des
produits français et confirma
leur popularité dans le coeur des libanais, au niveau
des consommateurs comme des organisateurs de la manifestation,
elle mis aussi en exergue une évidente carence dans
la présence des PME françaises qui constituent
pourtant le véritable réservoir des exportations
françaises dans un pays ami et pourtant si proche.
Si dès 2005, une action d'incitation d'envergure
n'est pas mis en oeuvre à leur égard, il y
a fort à parier que beaucoup auront la gueule de
bois lorsque la Chine devancera la France dans la hiérarchie
des partenaires commerciaux du Liban.
Malheureusement, cette échéance est sans doute
plus proche qu'il n'y parait et les acquis seront bien difficiles
à préserver
En conclusion, si tout n'est pas sombre, il convient de
ne pas se tromper dans la définition des priorités
et la situation est sans doute plus urgente que les apparences
ne le laissent croire.
JM Druart |
Alain
Ducasse et Patchi s'associent pour l'ouverture d'un restaurant
de desserts à Beyrouth

Alain Ducasse au Liban avec l'enseigne "le
Tamaris"
LBV-
Novembre 2004-
Patchi et le Groupe du fameux restaurateur étoilé
Alain Ducasse inaugurent le 23 novembre 2004 à Beyrouth au Liban
:
" Tamaris, Restaurant de desserts ".
Situé au dernier étage de l'immeuble Patchi sur plus de 300m2,
Tamaris présente un univers dédié à la gourmandise. La carte est
volontairement courte et met l’accent sur le chocolat. Il compose
la moitié des plats de la carte. Les grandes références de la
pâtisserie française y sont présentes : macarons, mille-feuilles,
éclair, Saint Honoré, forêt noire, gâteau au chocolat. Mais aussi
des glaces et sorbets, des boissons chocolatées... Le restaurant
restera ouvert 7 jours/7 de 11 h à 2h du matin.
L'entreprise d'Alain Ducasse qui compte environ 950 employés (dont
430 en cuisine),
a réalisé 21 millions d'euros de chiffre d'affairesen 2003, gère
une chaîne hôtelière de plus de 500 établissements, une école
de cuisine, une maison d'édition, et totalisera, à la fin de 2004,
pas moins de 20 restaurants à travers le monde, en Europe, en
Afrique, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. Une réussite
et une ascension en forme de revanche pour celui que l'on surnomme
souvent "le miraculé" en référence
à l'accident d'avion dont il fut victime voilà vingt
ans et dont il fut le seul rescapé.
Une partie de sa légende va donc désormais s'écrire
à Beyrouth.
>>> Pour mieux connaitre Alain Ducasse et son groupe:
alain-ducasse.com

Reconstruction du Liban:
le CDR présente son nouveau plan
triennal 2004-2006
L’infrastructure physique se taille la part du lion dans l'enveloppe
prévisionnelle de 2,5 milliards de dollars
Beyrouth, Août 2004-
Le Conseil du développement et
de la reconstruction (CDR) a publié son programme pour la période
allant de 2004 à 2006. Le CDR prévoit un coût total de 2,5 milliards
de dollars pour l’exécution des travaux. Selon le rapport, les
projets d’intérêt national sont de l’ordre de 13 %, soit 429 millions
de dollars. L’infrastructure de base bénéficiera de 274 millions
de dollars (routes et autoroutes (74 %), télécommunications (15
%), électricité (11 %). Les secteurs productifs obtiendront 81
millions de dollars tandis que l’infrastructure sociale bénéficiera
de 53 millions de dollars (éducation – 50 %, développement socioéconomique
– 20 %, santé – 15 %). Enfin, les services de base recevront 21
millions de dollars, alloués essentiellement à l’eau potable.
Quant aux projets régionaux, ils se répartissent comme suit :
Mont-Liban 28 %, Nord 18 %, Sud et Nabatiyeh 17 %, Békaa 13 %
et Beyrouth 11 %. Globalement, il ressort du rapport que l’infrastructure
physique (routes, autoroutes, infrastructure) et la gestion des
eaux usées monopolisent à eux seuls 60 % des montants alloués,
soit 30% contre 34% des montants alloués entre 1992 et 2003 ;
suivie des adductions d’eau 29%, de l’eau potable et de l’irrigation
(12%), de l’éducation et de l’enseignement supérieur (8,5 %),
de l’agriculture et de l’irrigation (8,1%), du développement économique
et social (5%), de la santé publique (2,2%), du transport (2,1%)
et des installations sportives (0,8%). Parmi les projets les plus
marquants figure le projet du Litani, qui prévoit la construction
d’un tunnel et de réseaux qui vont couvrir les besoins en eau
de l’ensemble du Sud et d’une partie de la Békaa. Le coût total
de ce projet, qui s’étale sur cinq ans, est estimé à 500 millions
de dollars. Le CDR compte également construire, entre autres,
un grand campus pour l’Université libanaise, qui regroupera toutes
les facultés du Nord, une autoroute reliant Beyrouth à Masnaa,
une autre reliant Rayak à Baalbeck, des stations d’épuration des
eaux usées dans le Kesrouan et à Bourj Hammoud, et un boulevard
maritime à Antélias.
Financement
Le total du financement étranger obtenu jusqu’à présent s’élève
à 1,1 milliard de dollars. Le CDR prévoit également dans les trois
prochaines années un montant de 780 millions de dollars en financement
étranger, en plus de sommes spéciales affectées à la création
d’une station d’épurement de Bourj Hammoud (120 millions de dollars).
Le financement étranger couvrera alors 79 % des coûts du programme.
Dans son rapport, le CDR rappelle qu’entre 1992 et 2003, des contrats
ont été signés pour sept milliards de dollars, sur lesquels 5,6
milliards de dollars de contrats qui ont déjà été exécutés, tandis
que deux milliards de contrats sont toujours en cours d’exécution
dans différents secteurs : les secteurs productifs (228 millions
de dollars), les services de base (996 millions), les secteurs
socio-économiques (354 millions) et l’infrastructure de base (532
millions). Les principaux bailleurs de fonds sont surtout des
institutions régionales et internationales, mais également des
pays notamment, la Banque mondiale (15 %), le Fonds arabe pour
le développement (14%), la Banque européenne d’investissement
(11%), la Banque islamique de développement (10%), le Fonds koweïtien
et le Koweït (10%), le Fonds saoudien et l’Arabie saoudite (7%),
l’Union européenne (7%), la France et l’Agence française de développement
(6%), l’Allemagne (6%), suivie des différentes banques commerciales
(5 %). Les pays offrent souvent des dons alors que les institutions
accordent des prêts bonifiés à long terme avec un délai de grâce
de cinq ans et des taux d’intérêt assez bas (entre 2 et 5%). Le
CDR insiste dans son rapport sur l’importance des prêts à long
terme accordés par les institutions internationales, reflétant
une tendance de plus en plus marquée de recourir aux financements
extérieurs, alors que dans les années 1990, les projets étaient
financés à hauteur de 60 % par l’État.
Le Crédit Agricole abandonne
le contrôle de la BLF
7 Juin 2004-
Après le départ de France Télécom
de la gestion du réseau historique de télecommunication
cellulaire "Cellis", effectif depuis le 1er Juin, c'est
au tour du Crédit Agricole, actionnaire de la Banque Libano-Française
de tirer ou presque sa révérence!
En effet, la banque verte a ramené sa participation dans l’établissement
de 51% à 9%. C’est Farid Raphaël, PDG et principal actionnaire
de la BLF, qui a racheté les 42% détenus par le Crédit Agricole.
Selon la presse libanaise, Farid Raphaël aurait l’intention de
rétrocéder les parts récupérées auprès du Crédit Agricole à un
groupe d’investisseurs en cours de constitution. La décision du
Crédit Agricole de se désengager de la BLF aurait été motivée
par le fait que la banque verte aurait été contrainte, selon les
règles prudentielles de Bâle II, de provisionner 100% de son investissement,
le Liban étant considéré comme un pays à risque.
L'avenir dira si ce second retrait de la scène libanaise
marque une nouvelle ère dans les relations économiques
franco-libanaises qui viennent tout de même de perdre deux
de leurs acteurs historiques. De quoi faire naitre quelques inquiètudes
ou questions légitimes à moins que d'autres secteurs
ne viennent rapidement suppléer ces défections brutales.

France Telecom
ne gérera plus Cellis!
7 Avril 2004-
Après des mois, des années devrait-on dire, de rebondissements,
le sort des compagnies historiques des réseaux cellulaires
au Liban, Cellis et Libancell semble cette fois définitivement
scellé au soir du 6 Avril 2004.
Le gagnant de l'adjudication, l'Allemand Detecon, ayant choisi
la gestion de Cellis, c'est la société koweitienne
MTC qui récupère celle de LibanCell...
Il sera sans doute politiquement correct de dire que cela est
normal, conforme aux procédures et aux règles de
la libre concurrence; notre point de vue ne s'inscrira pas dans
ce cadre poli.
Si France Telecom via sa filiale rebaptisée Orange, quitte
aussi piétrement le marché libanais, c'est que rien
n'aura été fait pour qu'il la conserve. Pour une
poignée de quelques millions de Dollars, c'est donc le
fleuron de la présence française au Liban qui s'en
va.
C'est aussi tout un symbole des relations économiques franco-libanaises,
une page qui se tourne après dix années d'implantation.
Certes, il se murmure que le Président Chirac est excédé
du non-respect des engagements liés à ParisII, tout
comme Patrick Renauld qui, de Beyrouth, ne pratique pas la langue
de bois sur le sujet. Car enfin, il suffisait que Français
et Allemands s'entendent pour qu'ils gardent la contrôle
des deux réseaux et que France Telecom se succède
en quelque sorte à lui-même pour la gestion de Cellis.
On remarquera d'ailleurs que l'issue de ce dossier fait la part
belle aux capitaux du Golfe puisque Detecom y est associé
à des partenaires...saoudiens!
Manifestement, les politiques ont cette fois laissé faire,
au moment ou il semblait crucial d'intervenir pour affirmer la
primauté de la chose politique sur l'économie. Certes,
Jacques Chirac semble, par les temps qui courent, davantage concentré
sur ses problèmes domestiques que par la présence
française au Liban... Peut-être n'est-ce là
qu'un mouvement d'humeur aux conséquences sans doute mal
évaluées: à deux mois de "La France
expose", voilà bien à court terme une indifférence
sans doute calculée mais à contre-courant, et surtout
à long terme, une funeste erreur.
Il sera en effet bien difficile de "vendre" aux patrons
français la place de Beyrouth comme rampe de leur présence
au Moyen-Orient lorsque le symbole de celle-ci abandonne sa position.
Voilà la vraie dimension de l'enjeu qui était proposé
et que le Politique se devait de saisir: encore une occasion manquée...
JM Druart
Cellulaire: une page de l'histoire de la
téléphonie mobile au Liban est tournée Les
Allemands optent pour Cellis ; LibanCell aux Koweïtiens
L'article de Michel
Touma de
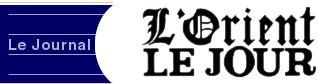
Le
suspense aura duré plusieurs mois. De très longs mois, marqués
par des guerres verbales, des manœuvres et des tiraillements qui
ont ébranlé, à plus d’une reprise, l’appareil de l’Exécutif. Le
suspense a pris fin hier – du moins pour cette phase de la privatisation
de la téléphonie mobile – avec l’annonce officielle de la décision
prise par la société allemande Detecon de porter son choix sur
le réseau Cellis pour la gestion du cellulaire pour le compte
de l’État, sur une période de quatre ans. Conséquence immédiate
et automatique de la décision allemande, c’est la société koweïtienne
MTC qui prendra en charge la gestion du réseau LibanCell (toujours
pour le compte de l’État et sur une période de quatre ans) du
fait qu’elle a été classée deuxième (derrière Detecon) dans l’adjudication
relative au réseau LibanCell. Du coup, la société française Orange,
filiale de France Telecom (classée deuxième, derrière Detecon,
dans l’adjudication relative au réseau Cellis) a été écartée.
Les Français étaient présents sur le marché libanais de la téléphonie
mobile depuis la mise en service du cellulaire au Liban, en 1994.
La société FTML, qui exploitait et gérait Cellis, était détenue
à 67 % par France Telecom. Le résultat annoncé hier a été accueilli
avec surprise et stupéfaction par une large fraction de l’opinion
publique. Les milieux locaux s’attendaient en effet (solidarité
européenne oblige) à une sorte de « gentleman’s agreement » franco-allemand
au terme duquel Detecon opterait pour le réseau de LibanCell afin
de permettre à Orange de prendre en charge la gestion du réseau
Cellis. Conformément au cahier des charges, c’est la société ayant
présenté le chiffre le plus bas pour chacun des deux réseaux qui
devait choisir elle-même lequel des deux réseaux elle désirerait
gérer. La décision de la société allemande (arrivée en tête de
chacune des deux adjudications) déterminait ainsi le choix du
second opérateur. La grande question qui se pose au stade actuel
est de savoir pour quelles raisons la solidarité européenne, et
plus particulièrement les relations privilégiées entre la France
et l’Allemagne, n’a pas joué dans le choix de Detecon (cette dernière
est une filiale de la société allemande T Systems, laquelle est
une filiale de Deutsche Telekom, et elle est associée à 49 %,
dans le cadre d’un consortium, aux deux groupes saoudiens FAL
et DETASAD).
Interrogé par L’Orient-Le Jour sur les raisons du choix de Detecon,
le vice-président de la société allemande, Dirk Munning (qui a
été reçu par le ministre des Télécommunications, Jean-Louis Cardahi),
a affirmé que la décision de Detecon a été motivée exclusivement
par des considérations d’ordre commercial et technique (voir par
ailleurs). Il reste qu’en coulisses, certains hauts responsables,
ainsi d’ailleurs que de nombreux Libanais, espéraient quand même
que les autorités françaises et allemandes concernées entreprendraient
des contacts discrets pour partager le marché entre les sociétés
Orange et Detecon. Ce souhait était motivé non pas par un manque
de confiance quelconque envers la compagnie koweïtienne (qui possède
toute l’expérience et les qualifications requises pour gérer le
réseau), mais plutôt par une volonté de consolider et d’affermir
l’ouverture du Liban en direction de l’Europe. Confier la gestion
de l’ensemble du réseau cellulaire à deux sociétés européennes
aurait, certes, rendu l’exploitation du réseau plus cohérente,
mais cela aurait surtout constitué un « message fort » de la part
du Liban au niveau de son ancrage à l’Europe, d’autant que le
pays est lié à l’UE par un accord d’association s’inscrivant dans
le cadre du partenariat euroméditerranéen. Des sources dignes
de foi indiquent dans ce cadre que la société Detecon a pris sa
décision concernant le choix du réseau qu’elle désirerait gérer
dès le 1er avril. Le ministre des Télécoms avait été aussitôt
informé de ce choix, mais il aurait demandé expressément à la
société allemande de ne pas rendre publique sa décision et de
laisser passer un délai de quelques jours avant de révéler son
choix. Ce laps de temps (de près d’une semaine) aurait pu être
mis à profit par les Français pour entreprendre les démarches
nécessaires auprès des responsables allemands afin de permettre
à Orange de se qualifier pour la gestion de Cellis. À l’évidence,
rien n’a été fait à cet égard, entendu que le ministre des Télécoms
ne pouvait nullement prendre une quelconque initiative sur ce
plan. Maintenant que les dés sont jetés, une étape de transition
qui s’étalera sur tout le mois de mai est prévue afin que FTML
et LibanCell passent la main aux nouveaux opérateurs. Ces derniers
devraient donc être opérationnels au début du mois de juin.
Dans la pratique, quel sera l’impact direct sur les abonnés
?
M. Cardahi espère, à court terme, obtenir de la part du Conseil
des ministres une décision visant à baisser le coût des communications
et des factures. Pour le ministre des Télécoms, il est en effet
normal et légitime que les utilisateurs puissent bénéficier de
l’économie que l’État enregistrera au niveau de la gestion du
réseau du fait de la dernière adjudication. M. Cardahi a déjà
saisi le Conseil des ministres d’une proposition en ce sens. Quant
à l’affiliation des abonnés à l’un ou l’autre des deux réseaux,
elle ne changera pas au cours des prochains mois. Interrogé à
ce sujet par L’Orient-Le Jour, M. Cardahi a indiqué que le ministère
prépare actuellement un nouveau plan de numérotation des lignes
téléphoniques, fixes et cellulaires, afin de mettre en service
des numéros à huit chiffres. Ce plan sera prêt à la fin de l’année.
C’est alors que les abonnés pourront – sans avoir à supporter
des frais supplémentaires – changer d’opérateur et choisir l’un
ou l’autre des deux réseaux, suivant leur préférence. Une page
est donc tournée dans la tumultueuse petite histoire de la téléphonie
mobile au Liban. Mais M. Cardahi n’en est pas pour autant au bout
de ses peines. Car plusieurs étapes doivent encore être franchies
pour mettre sur les rails le difficile processus de privatisation
du cellulaire et de l’ensemble du secteur des télécommunications
dans le pays. Reste à espérer que les petites manœuvres politiciennes
n’entraveront pas et ne retarderont pas, une fois de plus, la
tâche qui reste à accomplir dans ce domaine.

La place des Libanais
dans l'économie Sénégalaise
Les «Sénégalais d'ethnie libanaise» détiennent
60% des PME-PMI du pays
L'Express-Dakar ( 08/03/2004 )-
Tous les matins avant l'aube, Moussa Sharara fait sa gymnastique:
assouplissements, pompes, abdominaux. Puis il rejoint son champ,
non loin de Dakar, où, parvenu à l'âge de la retraite, il a démarré
une carrière… d'agriculteur! A 93 ans, ce fringant grand-père
a de l'énergie à revendre. «Le travail, c'est la santé! Quand
je suis inactif, je m'étiole», s'exclame le vieil homme au tonus
d'acier dont la saga familiale, avec ses 155 membres, fait penser
à une version «made in Africa» de la série télévisée Dynasty.
A l'automne 1937, le paquebot Champollion, parti de Beyrouth,
cingle sur une Méditerranée démontée, avec le jeune Moussa à son
bord. Un mois plus tard, après une escale à Marseille, ce villageois
du sud du Liban débarque à Dakar, la capitale de l'Afrique-Occidentale
française (AOF). Il y retrouve son cousin Souleymane, un grand
commerçant, tout comme lui de confession chiite, arrivé treize
ans plus tôt. Vendeur de cigarettes, puis négociant d'arachide
en brousse, il s'improvise photographe ambulant. Apprend le wolof
en huit mois. S'offre, avec ses premiers revenus, des cours de
grammaire et d'orthographe françaises. Le voici armé pour importer
du papier photographique, négoce qui fera sa fortune. Consécration
et symbole éclatant de sa réussite: il bâtit en plein centre-ville
«son» immeuble. Tous les appartements sont mis en location, à
l'exception d'un seul, que, par superstition, il habite toujours,
au cœur d'un quartier populaire: «Il faut rester fidèle aux lieux
qui vous ont porté chance.»
Leurs trajectoires sont emblématiques de l'intégration réussie
des Libanais d'Afrique
Père de famille, il élève sa progéniture selon un principe intangible:
«Etudiez d'abord! Pour l'argent, soyez patients: il sera encore
temps d'en gagner plus tard…» Disséminés au Canada, en France,
en Belgique, au Liban, ses 13 enfants ont retenu la leçon. Avocat,
ingénieur, prof de lettres, psychothérapeute ou informaticien,
ils possèdent tous des situations enviables.
A Monaco, Farouk est ainsi le «kiné» attitré du prince Rainier
tandis que son frère Nabil, médecin généraliste, soigne le gotha
du Rocher. Quant à Kazem, Fayçal, Aboudé et Amoudé, restés au
Sénégal, leurs trajectoires sont emblématiques de l'intégration
réussie des Libanais d'Afrique.
Ancien conseiller de l'ex-président Abdou Diouf, Kazem, l'aîné,
âgé de 60 ans, est une figure locale bien connue. Avocat d'affaires
doté d'un solide carnet d'adresses, il défend les intérêts de
la First International Bank (américaine) et de la République populaire
de Chine. Sans oublier ceux de plusieurs ambassades: Brésil, Inde,
Koweït. Il possède en outre une entreprise informatique. Et, surtout,
un flair infaillible: «Quand Air Afrique a déposé son bilan, j'ai
immédiatement créé une compagnie charter, en joint-venture avec
l'américaine World Airways pour rétablir la [NDLR: très rentable]
liaison Dakar-New York.» Résultat, Kazem peut tranquillement continuer
à rendre visite à son fils Walid, étudiant à Manhattan. Le 11
septembre 2001, ce dernier - décidément cette famille a un destin!
- se trouve au pied du World Trade Center lorsque les avions percutent
les tours jumelles. Secouriste, il se joint aussitôt aux sauveteurs.
Aujourd'hui, Kazem brandit fièrement le «brevet de courage et
de dévouement» décerné par la mairie de New York à l'étudiant
et s'exclame, non sans malice: «Mon fils est certainement le seul
Arabe au monde à posséder un tel diplôme!»
L'esprit de famille
Avec son menu international, La Fourchette est l'une des meilleures
tables de Dakar, fréquentée par une clientèle d'affaires. L'établissement
du cadet des Sharara, Amoudé, 38 ans, tourne bien. Du coup, ce
dernier a diversifié ses activités: traiteur, il organise désormais
des cocktails d'ambassade, des banquets privés et des événements
en tous genres. Un marché considérable. Sur la ligne d'arrivée
du Paris-Dakar, au bord du lac Rose, on peut voir ses buffets
dressés sur les dunes de sable, à l'ombre de tentes aux couleurs
de sponsors du rallye, ses clients. Prospère mais philosophe,
Amoudé n'a pas oublié ses débuts difficiles, qu'il évoque pudiquement:
«Dans l'adversité, mes grands frères m'ont toujours épaulé. Chez
les Sharara, on a l'esprit de famille. Quand c'est nécessaire,
les Libanais se serrent les coudes sans se poser de questions.»
Capitaine d'industrie de la filière pêche, associé - ce qui est
plutôt rare - à des Sénégalais de souche, Fayçal, 52 ans, est,
lui, l'enfant prodige de la fratrie. Vice-président du patronat
sénégalais, c'est un homme en vue dont les avis sur les questions
socio-économiques sont très écoutés. Après avoir redressé plusieurs
entreprises, il dirige une conserverie de thon, les Pêcheries
frigorifiques du Sénégal, et une usine de filetage, Amerger Casamance,
deux unités ultramodernes qui représentent 2 000 emplois.
On dit souvent, sous forme de boutade, que «libanais», ce n'est
pas une nationalité mais plutôt une profession. «Ce n'est pas
faux, sourit Fayçal. Très présents dans les professions libérales
et l'industrie, les Libanais sont les premiers investisseurs du
Sénégal. Ils possèdent 60% des PME-PMI. Et pèsent lourd en termes
d'emplois.» C'est la rançon du succès: ces talentueux businessmen
sont quelque peu jalousés. Et, du coup, accusés d'être à la source
de toutes les corruptions. «C'est bien connu: chaque Libanais
a un douanier et un policier dans sa poche», affirme sans nuance
un journaliste qui résume une idée répandue. Cependant, Babacar
Touré, président du groupe de presse Sud Communication, tempère:
«On utilise les Libanais comme bouc émissaire. Mais la corruption
est un mal national qui dépasse largement le cadre de telle ou
telle communauté. Dans les administrations, où ne travaille aucun
Libanais, les choses qui relèvent du droit s'obtiennent par des
passe-droits. Et on ne peut hélas que le constater: l'expression
courante “donner le prix de la kola”, qui désigne le bakchich,
est bel et bien africaine, non pas libanaise.» Une version des
choses confirmée par un inspecteur des impôts: «Sur 100 contribuables
d'origine libanaise, 95 en moyenne paient leurs taxes et impôts
rubis sur l'ongle. Mais cette proportion tombe à 40% parmi le
reste de la population…»
Citoyens «à part entière» mais aussi «entièrement à part», les
«Libanais» sont-ils des Sénégalais comme les autres? Fayçal Sharara
- qui «supporterait sans hésiter les Lions de la Teranga s'il
y avait un match de foot Sénégal-Liban» - revendique haut et fort
sa «sénégalité»: «Nous récusons l'appellation “Libanais”; nous
sommes bel et bien des Sénégalais d'ethnie libanaise! Car, si
nos parents étaient venus avec l'idée de faire fortune et de retourner
au pays, notre génération, elle, a coupé les ponts avec le Liban.»
Nombreux sont ceux qui, en effet, n'ont visité qu'une seule fois
la terre de leurs ancêtres.
«Les Libanais partagent des aspirations
communes avec le reste de la nation sénégalaise»
Pourtant, les Sénégalais d'origine libanaise vivent, c'est
vrai, repliés sur eux-mêmes. «Le communautarisme libanais n'est
pas différent de celui des Sénégalais de New York ou des immigrés
du monde entier. Et n'oublions pas qu'au temps de la colonie Arabes
et Africains fréquentaient des mosquées distinctes: ce cloisonnement
obligatoire a influencé les rapports sociaux, c'est certain»,
plaide Fayçal Sharara. Qui balaie une autre critique récurrente:
«On nous reproche l'absence de mariages mixtes. Mais l'intégration
ne se joue pas au niveau de la ceinture! Le fond du débat consiste
à savoir si les Libanais participent au développement du pays
et partagent des aspirations communes avec le reste de la nation.
La réponse est oui.»
Réputé pour sa stabilité, le pays de la teranga (mot wolof pour
hospitalité) n'est pas entièrement à l'abri de troubles intercommunautaires.
Les mini-émeutes de 1996, déclenchées par un fait divers, sont
encore dans les mémoires. Cette année-là, une employée de maison
est retrouvée assassinée au domicile d'un Libanais. Avant que
la police n'ait le temps de démasquer le criminel - un Nigérian
- la rue désigne spontanément la communauté libanaise à la vindicte.
Une foule hostile se masse dans le centre-ville. Avec l'aide de
certains médias, le mouvement est vite désamorcé. «Mais cet épisode
nous a profondément traumatisés. Ce fut un électrochoc», se souvient
Fayçal Sharara, qui décide alors, avec d'autres, de fonder l'Alliance.
L'objectif unique de cette association laïque est de rapprocher
les deux communautés, en remédiant au déficit d'image des Libanais.
Une conférence publique est organisée, pour briser tabous et non-dits.
«Il fallait mettre la “question libanaise” sur la place publique.
On m'a dit: “Tu es fou! ”; “Ne braquons pas les projecteurs sur
nous! ”, autrement dit: vivons cachés pour être heureux. A mon
sens, il faut au contraire sortir du ghetto et participer davantage
à la vie de la cité.» Depuis, l'Alliance a convaincu les Libanais,
ces abstentionnistes congénitaux, de la nécessité de sortir de
l'ombre en votant lors des élections, manière d'affirmer leur
citoyenneté.
Jusqu'à présent, rares sont les Libanais à s'être aventurés dans
les sables mouvants de la politique, hormis Kazem Sharara, ex-conseiller
du président Diouf, Fares Attyé, ex-militant socialiste, Samir
Abou Risk, aujourd'hui conseiller municipal de Rufisque, ou encore
feu Ramez Bourgi. Au vrai, ils ne s'y sentent pas les bienvenus.
«Pas un seul haut fonctionnaire, député ou ministre n'est d'origine
libanaise. Parmi 60 conseillers, le président Abdoulaye Wade n'a
pas daigné choisir un seul Libanais… Notre communauté comporte
pourtant des gens de talent qui, à l'instar des Corses en France,
estiment devoir être représentés au niveau de l'Etat», remarque
Samir Jarmache, vice-président de l'Alliance.
Dans ce contexte, le cas de l'hyperactif Fayçal Sharara représente
une exception. Depuis peu, il préside l'Ipress, la caisse de retraite
du Sénégal. Jamais avant lui une telle fonction, d'intérêt public,
n'avait été occupée par un Sénégalais d'origine étrangère. La
nomination de ce gestionnaire probe et compétent fait la fierté
des Libanais. Et inspire cette réflexion à son neveu Moussa (fils
de l'avocat Kazem), 26 ans, expert-comptable chez Ernst & Young
à Dakar: «Mon oncle Fayçal montre la voie. J'espère qu'un jour,
un Sénégalais d'origine libanaise ira encore plus loin. Et deviendra
maire de Dakar ou ministre des Finances. On peut rêver, non? Là-bas,
en Amérique du Sud, plusieurs Libanais sont bien devenus présidents
de la République…»

Investissima
2004 à Lausanne

Le Liban, pays charnière
entre l’Orient et l’Occident, est l’hôte d’honneur d’Investissima,
Salon suisse de l’investissement et de la prévoyance qui ouvre ses
portes demain.
Investissima reçoit cette année le Liban en tant qu’hôte d’honneur
de la manifestation qui ouvre le 27 Janvier à Lausanne pour
trois journées consécutives.
Cette présence pourrait se justifier par le simple fait que la Suisse
est le premier partenaire commercial de ce pays charnière du Proche-Orient.
L'AGEFI,
grand quotidien suisse de la finance est le principal partenaire
presse de cet évènement et a interrogé pour
l'occasion M.Marwan Hamadé, Ministre libanais du commerce
et de l'économie.
|
Conférence
13h15-15h30, salon Lausanne
LE LIBAN - Hôte d'honneur
1) Son Excellence Monsieur Marwan
Hamadé, Ministre de l'Economie et du Commerce de la République
Libanaise
2) LE LIBAN, une économie ouverte et un secteur bancaire
performant
Adnan Kassar, Président de la Fédération des chambres de
commerce, d'industrie et d'agriculture du Liban - représenté
par M. Mansour Bteish, Directeur général adjoint Fransabank
sal et directeur général Fransa Invest Bank sal
3) SOLIDERE : un concept d’investissement financier réussi
de développement urbain Mounir Douaidy, Directeur général
de SOLIDERE, The Lebanese Company for the Development and
Reconstruction of Beirut Central District, s.a.l www.solidere.com
4) IDAL : Le Liban économique Alain Bejjani, Vice-Président
d’Investment Development Authority of Lebanon www.idal.com.lb
5) Le Contexte Général des Investissements au Liban" Dr
Freddie Baz, Responsable de la Stratégie, Banque Audi sal
16h00 Cocktail / plateforme de discussions
|
Le Tourisme au Liban est très
sensible à l'environnement régional
Illustration sur l'année
2003...
Le Liban a franchi
la barre du million de touristes fin 2003 pour la première
fois depuis 20 ans!
Beyrouth 19 Janvier 2004- Le
Liban a franchi la barre du million de touristes fin 2003,
une première depuis environ 20 ans, selon les statistiques
du ministère du Tourisme. Plus de 1 015 950 visiteurs
ont été enregistrés en 2003 contre 956 464 en 2002, soit
une hausse de 6,2 %. Ce taux reste toutefois loin de celui
enregistré en 2002, qui a connu une hausse de 14 % du
nombre de touristes. Selon les chiffres du ministère,
les seules années où le nombre de visiteurs a dépassé
la barre du million ont été en 1972 (1 028 798 de touristes)
et en 1974 (1 423 950 de touristes). Ce bon résultat a
été cependant assombri par les mois de mars, d’avril et
de mai, sévèrement touchés par la guerre en Irak. L’arrivée
des touristes a chuté respectivement de 32 %, 23 % et
5 % par rapport à 2002. Par contre, les mois de juin,
juillet, août, septembre et novembre ont enregistré une
hausse de 4 %, 8 %, 23 %, 18 % et 27 % respectivement
par rapport à l’année précédente. L’afflux des touristes
a atteint son maximum en août avec 191 000 visiteurs.
Le chiffre record de touristes enregistré l’année dernière
malgré le contexte régional est dû notamment à l’afflux
des touristes de la région, qui, depuis le 11 septembre,
se détournent progressivement des destinations européennes
et américaines. Les visiteurs arabes viennent en tête
du classement des touristes par nationalités : 43 % du
total des visiteurs fin 2003 (à 438 000), suivis de l’Europe
(26,2 %), de l’Asie (13 %), des deux Amériques (11,8 %),
de l’Océanie (3,2 %) et de l’Afrique (2,2 %).
En octobre 2003, Newsweek avait souligné que Beyrouth
se trouvait parmi les 12 capitales de la mode, aux côtés
de Paris et de Los Angeles. Selon un autre numéro de la
revue, la capitale libanaise est, à l’instar de Tokyo
et de Rio de Janeiro, le meilleur endroit pour passer
le réveillon du Nouvel An.
Les ministères du Tourisme et de l’Économie comptent sur
une bonne activité touristique en 2004, grâce notamment
à une plus grande participation aux foires et aux salons
internationaux de tourisme et à une campagne publicitaire
d’un million de dollars sur CNN, qui sera lancée à la
fin du mois de janvier.

Le nombre de voyageurs
a augmenté de 5,5 % fin octobre Le Liban pourrait franchir
la barre du million de touristes fin 2003
Le Liban pourrait franchir la barre d’un
million de touristes d’ici à la fin de l’année. Selon
des chiffres publiés par le ministère du Tourisme et repris
par le Saradar Weekly monitor, le nombre de touristes
a totalisé, sur les dix premiers mois de l’année 2003,
environ 891 000 visiteurs, soit une augmentation de 5,5
% par rapport à la même période en 2002. Ces statistiques
ne comprennent pas les voyageurs syriens, palestiniens
et libanais, précise le ministère. En octobre, le nombre
de touristes a atteint près de 73 000, soit une augmentation
de 4,2 % par rapport à octobre 2002. En septembre, ce
chiffre a totalisé à 100 000 touristes, soit plus de 21,5
% que la moyenne des visiteurs enregistrés à chaque mois
de septembre entre 2000 et 2003. L’activité touristique
en 2002 avait enregistré une croissance de 14,3 %, avec
0,9 million de visiteurs. La guerre d’Irak a eu un impact
négatif sur l’activité touristique en mars et avril 2003,
mais elle a ensuite repris de juin à septembre, avec une
croissance de 12,8 % par rapport à la même période de
l’année dernière. Les pays arabes viennent en tête du
classement des touristes par nationalités : 44,1 % du
total des visiteurs, suivis de l’Europe (25,6 %), de l’Asie
(13,4 %), des deux Amériques (11,6 %), de l’Océanie (3,1
%) et de l’Afrique (2,1 %).
Guerre d'Irak:
Chute de 10% du nombre de touristes au Liban pour les
quatre premiers mois de l'année
Comme les professionnels du tourisme au
Liban le pressentaient, la situation internationale et
régionale n'a pas épargné le secteur.
Le mois d'Avril, point d'orgue du conflit irakien a été
marqué par une chute de 23% du nombres de visiteurs
avec seulement 41165 contre 53452 en 2002.
ce chiffre est d'ailleurs le reflet de l'activité
de l'aéroport de Beyrouth dont le traffic passager
a chuté de 13% et celui des avions de 26%!
Ce sont les touristes en provenance de l'Europe de l'Ouest-28,3%
du total-qui ont le plus évité le Liban,
en recul de 13% par rapport au quatre premiers mois de
l'année passée.Mais les touristes arabes-37,8%
du total- ont également chuté de 12% et
ceux de l'Asie-environ 17% du total- ont baissé
quant à eux de seulement 7%.
Au total ce sont 193000 visiteurs contre près de
215000 en 2002, qui sont venus au Liban durant les quatre
premiers mois de l'année.
Il sera donc très difficile d'atteindre l'objectif
de 800.000 touristes au Liban pour l'ensemble de 2003.
Qu'à cela ne tienne, si l'on pouvait atteindre
le million pour 2004! l'espoir fait vivre...
JMD -LibanVision
mais
la période d'été Juin-Septembre est
bien partie pour compenser ces pertes si l'on se fie au
trafic aérien de l'Aéroport de Beyrouth
|
Au Liban, qui se
débat lui aussi dans une crise économique aiguë,
la bonne nouvelle est venue du tourisme. Le nombre
de visiteurs a augmenté de 4,1% les huit premiers
mois de l'année 2003 par rapport à cette période
de 2002. "Le tourisme croît régulièrement et, cette
année, il y a eu un boom malgré les effets négatifs
de la guerre (en Irak) sur toute la région", a indiqué
un responsable du ministère du Tourisme. Malgré
un recul en début d'année, "nous avons réussi à
remonter la pente grâce aux excellents chiffres
de juin, juillet et août", selon lui. Le ministre
de l'Economie Marouane Hamadé a indiqué que le flux
des visiteurs arabes était dû aux mesures de sécurité
renforcées en Occident après les attentats du 11
septembre 2001, et à l'appréciation de l'euro qui
a rendu chères les destinations européennes traditionnelles.
Au total, 718.193 étrangers ont visité le Liban
jusqu'à fin août, les visiteurs arabes représentant
la part du lion, suivis par les Européens.
|
Pour l’aéroport de Beyrouth
ou encore pour les compagnies d’aviation opérationnelles
au Liban, l’été 2003 semble bien faste. Actuellement,
ces entreprises se préparent aux grands départs et l’overbooking
est roi, au point que certains agents rêvent de «pouvoir
installer les passagers sur les ailes des avions ». De
juin à septembre, des vols supplémentaires réguliers ont
été prévus. D’autres vols appelés «extrasections», que
les compagnies ajoutent à leurs horaires selon les besoins,
figurent également au programme de plusieurs entreprises.
Qui sont les passagers qui ont emprunté les vols vers
et à partir de Beyrouth? Des touristes arabes certes mais
aussi et surtout des Libanais établis à l’étranger retournant
au pays pour les vacances et en provenance notamment des
États-Unis, du Canada, d’Amérique latine et d’Europe.
Pour les mois de juillet, d’août et de septembre, la
MEA a ajouté à ses vols réguliers – qui affichent
complet – 26 «extrasections», qui desserviront les lignes
de Beyrouth-Ryad (4 vols réguliers par semaine), Beyrouth-Koweït
City, Beyrouth-Dubaï et Beyrouth-Londres (trois destinations
desservies chacune par un vol quotidien régulier) et Beyrouth-Paris
(trois vols quotidiens en collaboration avec Air France).
À la MEA, on n’omet pas de préciser que les vols qui empruntent
d’autres lignes européennes et arabes, notamment les allers-retours
vers Francfort, Düsseldorf, Amman et Le Caire, sont pleins.
Certaines compagnies d’aviation arabes ont pratiquement
doublé le nombre de leurs vols desservant Beyrouth. C’est
le cas de Qatar Airways qui effectue tout au long de l’année
un vol régulier de Beyrouth à Doha et vice versa. De juillet
à septembre, la compagnie a décidé de desservir cette
ligne avec deux vols quotidiens réguliers.
La bonne humeur règne à la Saudi
Airlines, laquelle affiche complet depuis le début
de l’été. Et depuis le 10 août, ce sont les avions qui
empruntent le chemin du retour vers les villes saoudiennes
qui sont pleins à craquer. En basse saison, la compagnie
saoudienne dessert le Liban avec 10 vols réguliers par
semaine, 5 au départ de Djeddah et 5 autres au départ
de Ryad. Du 15 juin au 30 septembre, une dizaine de vols
réguliers hebdomadaires ont été ajoutés. Ainsi, depuis
le début de l’été, tous les jours, deux avions atterrissent
à Beyrouth, l’un en provenance de Djeddah et l’autre de
Ryad. Les mercredis et samedis, un vol en provenance de
Dammam se pose à l’AIB. À la fin du moins d’août, et si
le besoin s’en fait sentir, la compagnie mettra à la disposition
de ses passagers cinq vols supplémentaires.
Les avions de la KLM, de
la British Airways et d’Air
France, en provenance ou en partance vers Amsterdam,
Londres et Paris, affichent également complet. Auprès
de ces compagnies, on vous parle surtout des émigrés libanais
qui prennent l’avion de New York, Montréal, Rio, Bogota
et beaucoup d’autres villes du Nouveau Continent, pour
emprunter ensuite une connexion d’une capitale européenne
vers Beyrouth. La KLM, qui avait allégé ses activités
vers la capitale libanaise durant la guerre d’Irak, a
repris ses vols quotidiens réguliers vers Beyrouth dès
le mois de juin. Les avions sont pleins et selon le nombre
des passagers, deux types de Boeing opèrent la ligne Amsterdam-Beyrouth.
On précise également que du 25 août au 7 septembre, les
avions de la ligne Beyrouth-Amsterdam sont surbookés.
Même son de cloche à la British Airways, où l’on explique
– comme partout ailleurs – que de la mi-juin à la mi-juillet,
ce sont les avions qui arrivent à Beyrouth qui «font face
à la pression». Au mois d’août, c’est le départ de la
capitale libanaise qui devient difficile. Dès la fin de
ce mois et jusqu’au 10 septembre, les avions de la British
Airways sont surbookés. La plupart des passagers qui empruntent
les 11 vols hebdomadaires Beyrouth-Londres (et vice versa)
de la compagnie sont libanais. Ils effectuent des correspondances
dans la capitale anglaise vers plusieurs destinations
américaines.
Air France a maintenu ses trois vols quotidiens vers
Beyrouth, en collaboration avec la MEA. Pour l’été 2003,
quatre extrasections, soit quatre vols supplémentaires
ont été prévus. Deux sont assurés par l’entreprise française
et deux autres par la compagnie libanaise. Les passagers
des avions d’Air France, pleins depuis le mois de juin,
ne viennent pas uniquement de Paris mais aussi de diverses
villes d’Amérique du Nord et d’Amérique latine ainsi que
des capitales africaines, Air France étant l’une des rares
compagnies présentes au Liban à desservir les pays d’Afrique
française.
Plus de 350000 voyageurs (transit,
aller et retour) ont emprunté, au cours du seul mois de
juillet dernier, l’aéroport de Beyrouth. Selon les informations
dispensées par l’AIB, ce chiffre est supérieur de 14%
à celui enregistré en juillet 2002. Pour l’AIB et pour
les compagnies d’aviation, l’été 2003 était bien faste.
Une manière peut-être de couvrir les pertes occasionnées
par la guerre d’Irak et sans doute d’effectuer des gains.
Patricia Khoder - L'Orient-Le Jour
|
Un rapport alarmant du Pnud et du CDR:
le Liban s’appauvrit dangereusement vite

scène quotidienne encore
impensable il y a quelques années au Liban...
Présenté le 19 Novembre 2003 à la Maison
des Nations unies, un rapport conjoint publié par le Pnud et le
CDR aligne des chiffres troublants : plus de 35 % de la population
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Selon une enquête plus
récente, la pauvreté s’est encore accentuée : 7, 1 % des ménages
subsistent dans l’extrême indigence et 2,5 % de la population
ne mangent pas à leur faim. Le coefficient Gini, utilisé pour
mesurer la pauvreté et variant entre 0 et 1 (0 pour les plus riches
et 1 pour les plus pauvres) se chiffrait, il y a quelques années,
au taux alarmant de 0,4. Par comparaison avec les pays européens,
cet indice ne dépasse pas 0,2. Ces chiffres qui ne sont pas tirés
d’une même étude méritent cependant d’être soulignés car ils montrent
que le Liban est bel et bien engagé sur la voie de l’appauvrissement.
Sept points précis sur la situation du développement durable au
Liban : la pauvreté, l’éducation, l’égalité entre les hommes et
les femmes, la mortalité infantile, la santé maternelle, le sida
et l’environnement. Et un huitième point : le partenariat entre
le Nord et le Sud en matière de développement. Tels sont les chapitres
du rapport libanais sur « les objectifs du millénaire », un document
publié conjointement par le Pnud et le CDR et qui présente, entre
autres, les défis fixés au cours du sommet qui porte le même nom,
tenu à New York en septembre 2000. *Afin de pouvoir relever ces
défis, un état des lieux fourni par chaque pays est nécessaire.
Hier donc à la maison des Nations unies, le rapport libanais sur
les objectifs du millénaire a été rendu public. Ce document, clair
et concis, a nécessité plus d’un an de préparation. Il ne présente
pas des études ou des chiffres nouveaux sur la pauvreté, l’éducation,
l’égalité entre les sexes ou encore les aides versées au Liban,
mais il traite ces points précis à la lumière de diverses études
de terrain et de sondages réalisés entre 1995 et 2002 (voir par
ailleurs), donnant ainsi une idée plus précise de la situation.
Il a fallu pour la rédaction du rapport la création de deux comités,
l’un consultatif et l’autre technique. Leurs membres sont formés
de représentants de divers ministères et administrations et de
délégués d’agences onusiennes. C’est que ce rapport est un document
national qui devrait englober tous les ministères et services
impliqués dans divers secteurs du développement (finances, santé,
éducation, environnement) ainsi que plusieurs agences onusiennes
présentes sur le terrain. Pour donner davantage de poids à ce
document, un représentant de la présidence du Conseil des ministres
figurait parmi les membres du comité consultatif. Le secteur privé
et les ONG qui tiennent généralement un rôle non négligeable dans
le développement durable n’ont pas participé à la création de
ce rapport national. Et probablement pour ne pas les marginaliser
entièrement, on a fait appel à un membre du Conseil économique
et social qui a eu sa place au comité technique. Même si le rapport
ne fournit aucun chiffre nouveau sur la situation du développement
au Liban, comme l’indice de pauvreté ou le volume de la dette
accumulée depuis plusieurs années, il n’en demeure pas moins intéressant
: chaque chapitre du livre présente un état des lieux sur un thème
donné, et en quelques pages les chiffres, les recommandations,
les points forts et les défis à relever sont traités. Beaucoup
de données, même si elles ne sont pas récentes, méritent d’être
soulignées : – La pauvreté qui progresse dans un pays qui était
connu au cours des années soixante-dix et quatre-vingt pour l’importance
de sa classe moyenne. – La disparité qui existe sur tous les plans
entre la capitale et les régions périphériques. Les chiffres présentés
mettent l’accent sur cette différence. – Et enfin la situation
économique du pays : les chiffres disponibles sur les échanges
commerciaux, la dette extérieure, le chômage des jeunes sont éloquents
même si le texte qui les accompagne a probablement été rédigé
pour minimiser leur impact sur le lecteur.
Plus de 2, 5 % de la population ne mange
pas à sa faim
Pour le premier thème relatif à l’éradication de la pauvreté,
c’est une étude qui avait fait grand bruit en 1995 qui a été utilisée.
Elle est accompagnée d’autres données, plus récentes. Au Liban
donc en 1995, 35 % de la population vivait au-dessous du seuil
de pauvreté, 6,3 % étant dans l’extrême indigence et 18 % subsistant
avec moins de 2,2 dollars par jour. Une étude plus récente, effectuée
en 1999, montre que la pauvreté n’a pas été réduite et que 7,1
% des ménages vivent dans l’extrême indigence. De plus, 17 % de
la population (soit 1/5) constituent 4 % du volume des consommateurs.
Une étude menée en 1996 montre également que le coefficient Gini,
utilisé pour mesurer la pauvreté et qui varie entre 0 et 1 (0
pour les plus riches, 1 pour les plus pauvres) est égal au Liban
à 0,435. Alarmant, selon les experts. Le texte souligne également
que plus de 2,5 % de la population libanaise ne mange pas à sa
faim. Et tout comme en 1995, en l’an 2000, 3 % des enfants libanais
étaient mal nourris. Ces chiffres méritent d’être revus selon
les régions. Les plus pauvres vivent dans les zones rurales et
les bidonvilles. 22,2 % de ceux qui sont dans l’extrême pauvreté
habitent le Hermel, 21,8 % Baalbeck, 19,4 le Akkar, 16,7 % Bint
Jbeil… alors que le taux national dans cette catégorie des plus
indigents se chiffre à 7,1 % et atteint ses niveaux le plus bas
au Kesrouan et à Aley (0,4 %), à Beyrouth (0,7 %), ainsi qu’au
Chouf et à Baabda (1,3 %). Tels sont quelques chiffres présentés
et commentés dans le premier chapitre du document. Les six autres
sections qui traitent de l’éducation, l’égalité entre les sexes,
la mortalité infantile, la santé maternelle, le sida, la malaria
et la tuberculose ainsi que l’environnement se poursuivent dans
le même esprit. C’est le chapitre huit, consacré au partenariat
entre le Nord et le Sud, qui détonne. Dans cette section, les
rédacteurs du texte vantent la mondialisation, la privatisation,
la libéralisation des marchés, la réforme structurelle. Ils soulignent
les points forts et les efforts louables déployés par le Liban
: accès massif à l’Internet et aux médicaments, prochaine adhésion
à l’OMC, entrée dans l’espace Euromed, Paris II…Ils vont même
jusqu’à rendre hommage « à la diaspora libanaise qui joue un rôle
significatif dans le développement du pays ». « Grâce à ses émigrés,
le Liban s’étend bien au-delà de ses frontières », indique-t-on.
Il est bien dommage que tous ces défis à relever, ces belles idées
et ces importants projets ne soient pas soutenus par des chiffres.
Et un tel document ne peut se suffire de prose. Quelques données
chiffrées ont été cependant glissées dans cette section et elles
ne collent pas beaucoup à l’image que l’on a voulu donner de ce
Liban esquissé dans le chapitre huit. En matière de finance et
de commerce, le rapport indique que l’exportation de biens se
chiffrait en l’an 2000 à 13 % du PIB. Ce taux a augmenté en 2001
pour atteindre 25 %. Évaluant la dette contractée depuis les années
quatre-vingt-dix, les auteurs rappellent qu’en l’an 2000, le déficit
budgétaire était estimé à 24 % du PIB et la dette publique avait
atteint les 23 milliards de dollars. En 2002, la dette publique
a encore augmenté pour atteindre quelque 30 milliards de dollars,
soit 173 % du PIB. Le service de la dette a également progressé
au cours des années précédentes. De 16,9 % du PIB en l’an 2000,
il était à 18 % en 2002, absorbant ainsi 80 % des revenus du gouvernement.
Faisant la lumière sur l’aide de la communauté internationale
après la guerre, le texte précise que le Liban avait reçu à la
fin de 2002 5,1 milliards de dollars d’aide divisée en 56 % de
crédits bonifiés et 44 % de crédits commerciaux. L’aide au développement,
elle, a atteint en l’an 2000 197 millions de dollars. Les auteurs
n’oublient pas de préciser que le chômage touche de plus en plus
les jeunes : 1/5 des personnes âgées entre 15 et 24 ans et 10
% des hommes âgés entre 25 et 29 ans sont sans emploi. « Le chômage
parmi les jeunes ne fait qu’augmenter l’émigration », relève le
texte. Le rapport prochain pourra sans doute vanter encore plus
la diaspora libanaise, présente partout et en augmentation constante.
Le deuxième rapport, mettant à jour ces mêmes données et mesurant
les progrès effectués, devrait être publié en 2007.
Priorité à la mise en place d’une stratégie nationale
C’est lors d’une conférence tenue à la maison des Nations unies
hier que le rapport national sur les objectifs du millénaire a
été rendu public en présence de responsables de divers ministères,
de délégués d’agences onusiennes et de diplomates. Prenant la
parole, le représentant permanent du Pnud au Liban, Yves de San,
a présenté les objectifs du millénaire, soulignant que « plus
de 128 États membres des Nations unies se sont engagés entre autres
à éradiquer l’extrême pauvreté, assurer l’éducation primaire et
contrer le sida d’ici à l’an 2015 ». Relevant que le rapport libanais
est le fruit de la coopération entre le système des Nations unies
et le gouvernement, il a souhaité que le Liban puisse relever
les défis du millénaire. C’est ensuite le président du CDR, Jamal
Itani, qui a pris la parole pour rappeler que les chiffres utilisés
dans le rapport ne sont pas récents. Commentant les défis à relever,
il a appelé à la mise en place d’une stratégie de développement
national, soulignant la nécessité de fixer les besoins du Liban
à la lumière des recommandations du rapport. Zeina Ali Ahmed,
responsable au Pnud, Ziad Abdel-Samad, rédacteur du rapport et
Amal Karaki, coordinatrice des projets du Pnud au CDR, ont présenté
le rapport. Un débat a ensuite a été organisé. Nader Srage, conseiller
de presse auprès du CDR, a souligné l’importance d’impliquer les
jeunes, seuls facteurs de changement, dans le débat, alors que
Kamel Méhanna, président de l’association Amel, s’est demandé
pourquoi une stratégie de développement n’a pas encore été adoptée,
et pourquoi le texte ne fournit pas de chiffres sur la classe
moyenne qui régresse et ne met pas l’accent sur la corruption.
Au cours des mois de janvier et de février, des tables rondes
et des conférences seront organisées par le Pnud et le CDR sur
les divers thèmes traités par le rapport.
Éducation : 82 % du budget partent en
salaires…
Le Liban est l’un des pays les plus avancés de la zone en matière
d’éducation. Le deuxième défi du millénaire relatif à la scolarisation
primaire des tout-petits libanais n’est donc pas difficile à atteindre.
En l’an 2000, 98,3 % des enfants étaient inscrits à l’école primaire.
Un chiffre qui a progressé depuis 1996. Pour la tranche des Libanais
âgés de 15 à 24 ans, le taux d’alphabétisation s’élevait, en l’an
2000, à 97,5 %. Cependant, ces chiffres trop beaux sont contrés
par des données d’une autre étude. Celle-ci montre que parmi les
enfants qui fréquentent l’école primaire, 66 % uniquement ont
véritablement assimilé et acquis les matières enseignées. En 1999,
11 % du PIB était consacré à l’éducation. La part des dépenses
du gouvernement dans l’éducation s’élevait à 7 % en 1993, 6, 31
% en 1996 et 0,06 % en 1999. Il faut aussi savoir que 82 % du
total de la somme publique versée à l’éducation est utilisé pour
le paiement des salaires des enseignants et du personnel administratif.
Sur le plan des ménages, l’enseignement figure au troisième rang
des dépenses, après la nourriture et les transports. Dans ce cadre
aussi, il faut souligner les disparités entre les régions. Le
Akkar compte 30, 5 % d’illettrés, contre 7,7 % au Chouf. La scolarisation
varie elle aussi selon les régions. Pour l’année scolaire 1998-1999,
elle s’élevait à 82,5 % au Mont-Liban, 80,3 % à Beyrouth, 78,5
% au Liban-Sud, 74,3 % dans la Békaa et 74,1 % au Liban-Nord.
Égalité des sexes
:
lois, emplois et salaires discriminatoires
envers les plus faibles Certains experts qualifient de « catastrophique
» l’égalité entre les hommes et les femmes au Liban. Et ce n’est
pas uniquement à cause de quelques lois discriminatoires à l’encontre
des femmes, notamment la loi sur la nationalité et le code d’état
civil. Et pourtant, quand ils naissent, les petits Libanais et
les petites Libanaises ont le droit à la même scolarisation, voire
à une éducation meilleure pour les filles. Le taux d’abandon scolaire
des garçons qui s’enrôlent trop tôt dans la vie active (7,8 %)
est un peu plus élevé que celui des filles (5,5 %). Ces chiffres
de l’école primaire augmentent en suivant la même tendance jusqu’au
cycle secondaire. C’est avec le temps que tout se complique. Ainsi
même si elles travaillent, les femmes accèdent rarement à des
postes de responsabilité. En 1996, seulement 8,5 % des cadres
des entreprises étaient des femmes. À tâches égales, le salaire
des hommes est plus élevé. Ainsi en 1997, le salaire moyen d’un
homme se chiffrait à 606 000 livres contre un salaire variant
entre 300 000 et 500 000 pour la moitié de la population active
féminine. Seulement 11 % des femmes au travail gagnent plus d’un
million de livres par mois. Sur le plan de l’administration et
des postes de prise de décision, beaucoup d’effort reste à faire.
Le Parlement, par exemple, formé de 128 députés compte 3 femmes,
soit 2,3 % de la Chambre. Mais ne forment-elles pas la majorité
de l’électorat ? Côté illettrisme, on compte, selon la moyenne
nationale, 17,8 % de femmes adultes analphabètes contre 9,3 %
d’hommes qui ne savent ni lire ni écrire.
Environnement : beaucoup reste à faire
Le Liban a ratifié plusieurs conventions pour la protection de
l’environnement. Et le Parlement a même adopté un code de l’environnement
en août 2002. Mais nous sommes bien loin d’être un pays modèle.
En 1999, le Liban comptait 33 réserves naturelles, dont sept reconnues
par la loi. Pourtant ces zones ne constituent que 0,2 % du territoire.
De plus, on compte uniquement 888 hectares de côtes protégées.
Dérisoire pour un pays qui a une façade maritime d’environ 190
kilomètres. Et le Liban vert n’existe que dans l’esprit de ceux
qui le vantent : les forêts couvrent uniquement 13,3 % du territoire.
80 % des déchets solides sont enterrés dans des dépotoirs. Et
ce n’est pas tout. Seulement 37 % des habitations étaient reliées
en 1996 à des réseaux d’égouts. Le reste des ménages, notamment
dans les zones rurales, utilisaient les fosses septiques. Dans
ce domaine, il faut notamment souligner les disparités entre les
régions. À Nabatiyé, seulement 23,8 % des habitations sont reliées
à des réseaux d’égouts contre 98,3 % à Beyrouth.
Un dossier
réalisé par Patricia Khoder
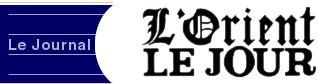
20 Novembre 2003

Le Développement de la
Grande Distribution:
Enjeux et Conséquences
Colloque organisé
à l'ESA le 10 octobre 2003

Le Programme
et les Intervenants:
Vendredi 10 octobre
- 8h30 Accueil et enregistrement des participants
- 9h00 Introduction : S.E. M. Marwan HAMADE, Ministre de l’Economie
et du Commerce, M. Roger OURSET, Directeur Général de l'ESA
- 9h30 Les nouveaux enjeux de la grande distribution dans le monde
- Conférencier : M. Marc DUPUIS (ESCP-EAP, CERIDICE)
- 10h00 Le développement de la grande
distribution :
les nouveaux marchés à conquérir
- Modérateur : M. Claude OBADIA (ESCP-EAP)
Participants :
M. Abdelmajid AMINE (Université Paris 12) : le cas du Maroc,
Mme Nathalie PRIME (ESCP-EAP) : le cas de l’Inde,
M. Edouard MONIN (Ipsos Stat) : les évolutions dans la région
- 11h00 Pause-café
- 11h30 Producteurs, importateurs et
distributeurs :
vers de nouvelles relations
- Modérateur : Mlle Sybille RIZK (L’Orient-Le Jour)
Participants :
M. Marco FABIEN (L’Oréal Liban),
M. Khalil FATTAL (Khalil Fattal & Fils),
M. Michel ABCHEE (ADMIC)
- 12h30 Déjeuner

- 14h00 Marques locales, marques mondiales
et marques de distribution : quelles strategies ?
- Modérateur :
M. Jean Jack CEGARRA (ESA, CRED)
Participants : M. Marc WAKED (Liban Lait),
M. Jean-Marc LANDRIAU (Almaza)
- 15h00 Le mall : un nouveau centre de vie
- Modérateur : M. Nicolas SBEIH (Commerce du Levant)
Participants : M. Olivier BADOT (ESCP-EAP) : le réenchantement
des malls, M. Karim FADEL (ABC) : Beirut Mall, un nouveau concept
au Liban
- 16h00 Pause-café
- 16h30 La distribution sélective et
spécialisée :
perspectives d'évolution
- Modérateur : M. Ibrahim TABET (Agence DDB Stratégies)
Participants : M. Nabil KETTANEH (Kettaneh), M. Jihad MURR (Virgin),
M. Samir BOGHOS (Paris Gallery), M. Nabil FAWAZ (Socodile)
- 17h30 Synthèse
- 18h00 Cocktail de clôture
Samedi 11 octobre
- 10h00 Visite en avant-première du Beirut
Mall (ABC Achrafieh)
Avec la collaboration du CERIDICE et DDB / Strategies
-----------
Frais de participation : 90$
TTC Tarif pour les diplômés de l’ESA : 65$ TTC Comprenant : Participation
à la journée de conférences, Pauses-Café, Déjeuner, Cocktail de
clôture, Actes du colloque, Visite du Beirut Mall (ABC Achrafieh)
Modalités de Paiement : Chèque
en USD à l'ordre de : ESA, 289, rue Clemenceau B.P. 113-7318 Beyrouth,
Liban Tél : 01.373 373 Fax : 01.373 374
e-mail : esainfo@esa.edu.lb
Le site des Anciens de l'ESA

Enjeux et conséquences du développement
de la grande distribution Modernisation et nouvelle répartition
des marges
-----------------------------
L’École Supérieure des Affaires
de Beyrouth organise le 10 Octobre un colloque sur les enjeux
et les conséquences du développement de la grande distribution
au Liban. Parrainée par le ministre de l’Économie et du Commerce,
Marwan Hamadé, la journée sera l’occasion de replacer cette évolution
dans un cadre plus général, grâce à l’intervention de spécialistes
qui parleront des évolutions mondiales du secteur de la distribution
et évoqueront les cas marocain et indien notamment. Le colloque
sera suivi, samedi, d’une visite en avant-première du Beirut-Mall,
le centre commercial développé à Achrafieh par l’ABC. Selon une
récente étude publiée par le cabinet d’experts immobiliers Ramco,
l’espace consacré au commerce de détail va quadrupler dans les
prochaines années pour passer à 500 000 mètres carrés environ,
soit une densité de 58 mètres carrés pour 1 000 habitants. Si
on considère la seule région de Beyrouth et du Mont-Liban, la
densité moyenne sera de 232 mètres carrés pour 1 000 habitants,
soit davantage que la moyenne européenne. Cette évolution sera
le fruit du développement de grandes surfaces, que ce soit des
supermarchés type Monoprix ou Spinney’s qui ont chacun prévu d’ouvrir
de nouveaux points de ventes, ou des hypermarchés, c’est-à-dire
de plus grands espaces encore. L’enseigne Carrefour devrait ainsi
faire son apparition à Dbayé, de même que Géant/Casino, à Nahr
el-Mott. Le premier est un projet du groupe émirati Majed al-Futtain,
l’autre fera partie du groupe Admic (Monoprix/BHV).
L’émergence de ces nouvelles enseignes ne changera pas seulement
le paysage urbain, elle s’accompagnera d’une redéfinition des
relations entre les principaux acteurs du circuit économique de
la grande consommation : producteurs, importateurs et distributeurs.
Car les nouveaux distributeurs sont appelés à contrôler une part
croissante du marché au détriment des petits commerçants, ce qui
les placera dans une position plus forte face à des importateurs
et des producteurs jusque-là habitués à traiter avec des clients
dispersés et fragmentés. Mais au-delà de ce nouveau rapport de
force, c’est le développement de tout un secteur qui est en jeu,
car l’introduction de la grande distribution bouleverse les habitudes
du secteur et conduit les uns et les autres à se moderniser au
profit du consommateur.
De nouvelles normes
« Il y a quelques années, les glaces étaient livrées aux détaillants
dans des glacières, pas dans des camions spécialement conçus pour
préserver la chaîne du froid », explique Michel Abchee, PDG d’Admic,
en guise d’exemple des améliorations que la grande distribution
introduit petit à petit. « Aujourd’hui encore, nous recevons des
bouteilles d’eau minérale en vrac, alors que nos entrepôts sont
conçus pour accueillir des palettes déchargées directement des
camions de livraison. » C’est que le grand chantier du développement
des circuits logistiques, de la gestion des stocks, etc. n’en
est encore qu’à ses débuts au Liban. Mais il est inéluctable pour
répondre aux nouvelles règles du jeu introduites, à coups de millions
de dollars, par les grandes surfaces modernes. « Nos magasins
sont aux normes européennes en matière de sécurité, de lutte contre
les incendies, de respect de la chaîne du froid, sans compter
le service que nous offrons aux consommateurs », fait valoir Michel
Abchee. Le directeur général de L’Oréal Liban, Marco Fabien, reconnaît
à la grande distribution ce rôle moteur, lié à sa capacité à attirer
des clients. « Nous sommes prêts à aider un circuit de distribution
dès lors qu’il est dynamique, c’est-à-dire qu’il contribue à développer
notre image de marque et à augmenter notre chiffre d’affaires
», dit-il. Khalil Fattal, président de Khalil Fattal&Fils, affirme
avoir applaudi à l’implantation de la grande distribution au Liban,
car « elle permet au consommateur final de bénéficier de prix
plus attractifs et d’une offre plus variée ».
Partage des coûts
Mais la première satisfaction générale passée, quand la grande
distribution est entrée dans une phase d’expansion géographique
qui nécessite de gros investissements, les relations entre fournisseurs
et détaillants ont commencé à se tendre. Les grandes surfaces
estiment en effet qu’elles doivent partager l’effort financier
avec les autres acteurs de la chaîne, ce qui fait bien entendu
grincer des dents. Spinney’s a pendant un certain temps reporté
sur ses fournisseurs une partie du financement de ses plans d’expansion,
abusant de l’absence de règlementation concernant les délais de
paiement. Le groupe a reconnu ses torts affirmant qu’il n’avait
pas été suffisamment capitalisé au départ. Mais au-delà de cet
épisode qui relève surtout de l’incident de parcours, c’est un
partage en bonne et due forme des coûts que souhaite la grande
distribution. « Nous avons investi dans un entrepôt central pour
tous nos magasins, ce qui se traduit par une réduction des frais
de livraison pour nos fournisseurs. En France, les distributeurs
négocient en échange des remises supplémentaires pour frais de
logistique. Ici, aucun fournisseur ne l’accepte », dit Michel
Abchee qui a donc décidé de demander une participation financière
sous une autre forme : le référencement payant.
Prendre à Pierre pour habiller Paul
La mesure qui est présentée par Monoprix comme une « simple adaptation
des habitudes européennes au marché libanais » a suscité une levée
de boucliers parmi les fournisseurs, qu’ils soient importateurs
ou producteurs. « Monoprix exagère », affirme par exemple Marco
Fabien de L’Oréal, même s’il juge les frictions actuelles normales
et estime qu’elles ne sont qu’une étape dans un partenariat appelé
à durer. Khalil Fattal met quant à lui en avant le fait que «
nous aussi sommes en train d’investir dans la logistique, la gestion
des stocks, l’informatique, la formation des vendeurs, etc. sans
demander à quiconque d’assumer une partie du coût ». Selon lui,
les importateurs représentant de grandes marques sont obligés
d’être à la pointe afin de rester compétitifs face à la libéralisation
des marchés, par la suppression de la protection des agences exclusives
promise par le gouvernement. « Nos marges sont déjà sous pession
», dit-il pour désamorcer l’appétit de la grande distribution.
Michel Abchee n’en démord toutefois pas : il affirme que certains
importateurs pratiquent des prix trop élevés et menacent ceux
qui ne sont pas compétitifs de les court-circuiter en important
directement les produits qu’ils représentent, comme la loi le
lui permet déjà pour les produits alimentaires. En fait, l’introduction
de la grande distribution entraîne inéluctablement une révision
du partage de la marge dans la chaîne. Sachant que, d’un côté,
la grande distribution est consciente qu’elle ne peut pas se substituer
entièrement aux importateurs, car cela représenterait un investissement
en matière de logistique et de stocks beaucoup trop important,
sans compter qu’elle n’a pas les moyens d’assurer le suivi commercial
et la promotion de tous les produits en rayon. Parallèlement,
les fournisseurs, qu’ils soient importateurs ou producteurs, sont
obligés de s’adapter à l’évolution des canaux de distribution
qui, par leur contact direct avec le consommateur, sont en position
de force. Les frictions qui accompagnent ce changement au Liban
sont amplifiées pour une raison bien simple. En période de stagnation
du marché, « on prend à Pierre pour habiller Paul », selon l’expression
de Marco Fabien, alors qu’en période de croissance, les transferts
sont plus indolores.
Sybille
Rizk
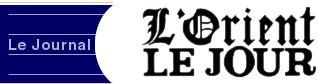
|
Le 12 Octobre,
journée
nationale de la Pomme au Liban

Le
président Emile Lahoud a montré l'exemple!
|

Eté 2003
Le Liban chute encore au classement
mondial du
développement humain publié par le PNUD
Que penser de cette 83ème
place du Liban sur quelques 175 nations ou les Nations-Unies étudie
le développement humain à travers trois critères
majeurs qui sont l'espèrance de vie, le niveau d'études
et d'instruction et le revenu par habitant?
Tout d'abord, il faut préciser que
cette chute est continue et sévère puisque le Liban
est passé de la 65ème à la 75ème place
entre 2001 et 2002 puis à la 83ème dans le rapport
2003.
Comment ne pas s'étonner alors des propos tant rassurants
de Mr Yves De San, le coordinateur résident des Nations-Unies
lorqu'il évoque par exemple le niveau de l'éducation
ou le Liban bénéficie d'une réputation enviable.
Il est certain qu'une infime partie de la population libanaise
est insensible à ces variations statistiques, mais quiconque
vit le Liban au quotidien dans toute la diversité de ses
composantes ne mettra pas en doute cette malheureuse régression.
Jusqu'à quand fera t-il bon vivre dans un si beau pays
que tant de ses jeunes cherche à quitter pour trouver un
mieux-vivre ailleurs?
Les acteurs qui ont jadis inondé le Liban de subsides pour
mieux diviser ses communautés sont-ils les mêmes
que ceux qui, aujourd'hui, tente de l'assécher économiquement
pour mieux profiter de son redressement demain?
Jusqu'ou laissera t-on tomber le Liban avant de commencer à
inverser cette courbe objectivement alarmante?
Autant de questions cruciales que doit soulever ce rapport à
quiconque mêle la lucidité et la responsabilité
à un amour du Liban et de ses valeurs profondes.
JM Druart
|
Juin 2003
Project Lebanon:
un Pavillon
France bien trop pâle...
C'est un drapeau français
bien trop discret qui flottait sur Project Lebanon, le grand salon
inter-régional de la Construction. Il a même failli
nous échapper lors de notre visite alors qu'il fut si fièrement
annoncé voilà moins de deux mois!
Quatre entreprises* ont tout de même
tenté de dignement représenter le Pays qui parait-il
entretient des rapports séculaires avec le Liban... Les
absents sont-ils trop sûrs d'eux ou ont-ils eu peur de se
déplacer au pays du cèdre? et même si certaines
entreprises françaises étaient indirectement présentes
via leurs agents locaux, ceci ne saurait expliquer cela.
En visitant Project Lebanon, nous avons cru que la Belgique était
vingt fois plus grande que la France, que l'Espagne brillait de
mille feux en Europe, que l'Allemagne partait à la conquête
de l'Orient après celle des pays de l'Est...
Il faut venir au Liban pour palper le dynamisme économique
des partenaires européens de la France pendant que cette
dernière est empêtrée dans ses réformes
et les grèves qui ne changeront rien au cours des choses.
Alors que la politique régionale
marque un tournant avec une offensive américaine tout autant
palpable, voilà que moins d'un an après les fastes
d'un sommet de la francophonie et du Forum francophone des Affaires,
nous donnons l'image d'un pays retombant dans ses vieux démons,
incapable de transformer concrètement les beaux discours
en actes concrets.
Bien sûr, les efforts
locaux de certains ont permis d'assurer un service minimum, mais
que dire des absents sinon qu'ils ont eu tort, comme toujours.
A ceux-là, nous osons dire qu'ils n'ont pas respecté
le Liban, son sens de l'hospitalité et son rôle de
porte d'entrée d'une région peut-être agitée
mais dotée d'un énorme potentiel.
Tant mieux pour ceux qui osent transcender les risques et tant
pis pour ceux qui préfèrent rester à la maison.
JM DRUART
* Matière
Sa, Airwell, Gate-Matic, TimberWood (Groupement des scieries françaises).
|
|
Beyrouth crée une zone
de libre-échange avec six pays arabes Les exportations représentent
aujourd’hui 16,2 % des revenus
Beyrouth -26 Juin 2003-
Les exportations libanaises ont connu ces deux dernières années
une croissance sensible enregistrant une hausse de 24,5 % en 2001
et 17,5 % en 2002. Ce qui représente près de 16,2 % des revenus
alors qu’en 1998 ce pourcentage n’était que de 10 % à l’ombre d’un
déficit chronique de la balance commerciale. Le Liban officiel n’a
pas lésiné sur les moyens pour élargir la base de ses échanges commerciaux
avec les blocs économiques. Il a ainsi signé l’accord de partenariat
avec l’Union européenne, il y a presque un an, et a entamé récemment
des négociations multilatérales et bilatérales en vue de son adhésion
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Beyrouth a par ailleurs
conclu des accords de coopération économique et commerciale avec
plus d’une trentaine de pays et créé une zone de libre-échange avec
six pays arabes qui sont la Syrie, le Koweït, l’Égypte, les Émirats
arabes unis, l’Irak et la Jordanie. Le Liban s’est engagé à mettre
en œuvre le programme pavant la voie à la création d’une zone de
libre-échange arabe prévue pour 2010 en plus de son engagement à
coopérer au niveau des normes et de la reconnaissance réciproque
des certificats d’origine avec la Syrie, l’Égypte, l’Irak et la
Jordanie. Lors d’un atelier de travail organisé sur l’état des exportations
libanaises, dans le cadre d’un séminaire organisé hier par la Fédération
des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Liban,
en coopération avec les ministères de l’Industrie et du Commerce
et la Fédération générale des Chambres de commerce, d’industrie
et d’agriculture des pays arabes, sur le thème « Les principes et
les moyens de développer les exportations arabes », Fadia Matar,
chef du département des exportations au ministère de l’Industrie,
a brossé un tableau du secteur basé sur des statistiques concernant
les partenaires du Liban à l’export, les problèmes de ce secteur
et les mesures adoptées par les autorités pour aplanir les obstacles
et élargir les marchés.
La répartition des exportations
La répartition des exportations sur les plus importants secteurs
industriels se présente comme suit : les machines et équipements
électriques 14 % ; les produits industriels chimiques 12,7 % ; les
produits agroalimentaires 12 % ; papiers et dérivés 11, 5 % ; perles
et pierres précieuses et semi-précieuses 10 %. Les difficultés que
rencontrent les industriels pour exporter leurs produits sont désormais
connues. Il s’agit notamment des coûts de production, de transport
et d’exportation élevés ainsi que du coût élevé du financement.
À cela, il faut ajouter les contraintes imposées aux exportateurs
libanais par certains pays en dépit d’accords signés entre leurs
gouvernements respectifs portant sur la libéralisation des échanges
commerciaux et la vigilance poussée à l’extrême dans l’application
des conditions d’ordre sanitaire et environnemental.
Incitations
Le gouvernement a tenté de réduire les coûts de production et d’améliorer
la compétitivité de l’industrie libanaise à travers l’adoption d’une
série de mesures. Il a ainsi aboli les taxes douanières sur toutes
les matières premières et tous les biens intermédiaires utilisés
dans l’industrie. Il a également révisé à la baisse les taxes portuaires
suivant la tendance baissière qui prévaut dans la région. La subvention
des intérêts servis sur les crédits accordés aux industriels est
passée de 5 % à 7 % alors que le montant des crédits subventionnés
est passé de cinq milliards de LL à quinze milliards de LL.
Liliane MOKBEL- L'Orient le Jour & le Commerce du Levant
|
L'INSEAD au Liban dès
le 1er Mars 2003
Insead
Liban ,
après Fontainebleau en France et Singapour en Extrême-Orient,
la prestigieuse école de perfectionnement au Management s'implante
à Beyrouth! En effet, dès Mars 2003, des sessions de formation
s'adresseront aux cadres expérimentés agés de 30
à 38 ans.Le cadre des premières formations sera le Berytech
de Mkallès-Mar Roukoz.Certains concurrents n''auront pas intérêt
à s'endormir sur leurs lauriers...Consultez donc le site Web de
l'Euro-Asia Center de l'Insead.
---
Un centre Commercial Géant
ouvira ses portes au Liban en 2004 avec les enseignes BHV et ...Géant
Casino comme moteurs!

C'est la société
Admic qui exploite déjà les enseignes BHV-Monoprix notamment
à Jnah qui est le promoteur de cetre opération qui peut
apparaitre autant gigantesque que risquée compte tenu des circonstances
économiques actuelles au Liban.
Cependant, comme le souligne son jeune et dynamique PDG, Michel Abchi,
l'emplacement choisi dans la zone de Dora à Jdeidé ainsi
que la marge de progression de la part d'achats réalisés
en grande surface au Liban - 35% contre 60% en France par ex. - atténue
largement ces risques et la faisabilité du projet est assez séduisante
pour avoir attiré un groupe d'investisseurs saoudiens à
hauteur de 10% de participation.
Même si la concurrence semble vive dans cette région avec
notamment la présence de Spinneys à Dbayé, le flux
des 200 000 véhicules par jour démontre la valeur stratégique
de l'emplacement contigu au stade Michel El-Murr le long de l'Autostrade.

Un "Géant" dans le sud de la France.
Ce ne sont pas moins qu'un
hypermarché de 11000 mètres carrés à l'enseigne
"Géant" bien connue en France mais aussi en Espagne,
en Amérique Latine ou en Californie, qu'un second BHV d'une superficie
de 18000 mètres carrés sans compter un grand espace de vente
Multimédia, une grande surface de Sport sur 2500 Mètres
carrés ou un complexe de huit salles de cinémas sans compter
de nombreux commerces, environ 90 répartis sur trois niveaux de
vente, qui garniront cet espace de quelques 175000 mètres carrés
qui pourra accueillir jusqu'à 2500 places de parkings.
Vous aurez donc tout le
loisir de regarder l'évolution des travaux si vous êtes bloqués
dans les embouteillages sempiternels de Dora côté Mer...
Ouverture prévue à la rentrée 2004...
----
15 Décembre 2002: Dossier Cellulaire, enfin vers l'épilogue...
L’appel d’offres pour la privatisation
peut désormais être lancé:
Après LibanCell, Cellis signe l’accord de transfert de propriété
du réseau
Comme prévu, le ministre des Télécommunications,
Jean-Louis Cardahi, et le PDG de la société FTML (Cellis), Salah Bou Raad,
ont signé samedi vers midi l’accord de transfert de la propriété du réseau
cellulaire à l’État. Un accord similaire avait été signé dans la soirée
de jeudi dernier avec le second opérateur, LibanCell. La signature de
ces deux documents pave ainsi la voie au lancement, dans les prochains
jours, de l’appel d’offres en vue de l’attribution de deux licences d’exploitation
de la téléphonie mobile pour une durée de 20 ans, sur base d’un cahier
de charges établi par la banque britannique HSBC.
La conclusion de ces deux accords de transfert de propriété du réseau
GSM à l’État est intervenue au terme de près de deux semaines de tractations
et de négociations fiévreuses entre le ministre des Télécommunications
et les deux sociétés chargées de gérer la téléphonie mobile pour le compte
du gouvernement jusqu’au 31 janvier 2003. Les deux opérateurs en question,
rappelle-t-on, exploitaient le réseau jusqu’au 31 août dernier, date à
laquelle la propriété du GSM est revenue officiellement à l’État. Mais
dans la pratique, ce transfert de propriété attendait la signature d’un
accord avec les deux opérateurs. Les principes de cet accord avaient été
définis par le Conseil supérieur pour la privatisation (CSP) et approuvés
le 28 novembre par le président Émile Lahoud et le chef du gouvernement,
Rafic Hariri, au cours d’une réunion tenue au palais de Baabda. Ils avaient
été avalisés le jour même par le Conseil des ministres.
Lors de cette séance du cabinet, M. Cardahi avait exprimé plusieurs réserves
concernant les principes du transfert de propriété définis par le CSP.
Le ministre réclamait, notamment, des garanties de paiement des mandats
de recouvrement d’un montant de 600 millions de dollars (300 millions
pour chacune des deux sociétés) que l’État réclame en compensation de
la violation des contrats initiaux en BOT en base desquels FTML et LibanCell
exploitaient le réseau GSM. Ces contrats en BOT avaient été résiliés unilatéralement
par le gouvernement en juin 2001. Les deux opérateurs avaient alors engagé
un arbitrage international pour contraindre l’État libanais à leur verser
des indemnités. Ce sont les détails de cette procédure d’arbitrage international
qui ont fait l’objet des dernières conditions posées par M. Cardahi à
FTML et LibanCell dans un document soumis aux deux opérateurs le mercredi
4 décembre.
En axant les négociations sur ces points de détails, M. Cardahi cherchait
ainsi à limiter les dégâts causés, selon lui, par l’accord avalisé le
28 novembre par le Conseil des ministres. De source proche de Baabda,
on précise que c’est à la demande expresse du président Lahoud que M.
Cardahi a posé certaines de ses conditions au sujet de la procédure d’arbitrage.
Dans un communiqué publié samedi à l’issue de la signature de l’accord
avec Cellis, le ministère des Télécommunications a indiqué que les deux
opérateurs avaient signé les documents sur le transfert de propriété conformément
aux conditions posées par le ministre dans le document du 4 décembre.
Le communiqué indique en outre que le ministère a transmis aux deux sociétés
une lettre en vertu de laquelle il s’engage à soumettre à l’arbitrage
international le litige concernant les mandats de recouvrement. Mais dans
le même temps, le ministère souligne que ces mandats de recouvrement ne
peuvent faire l’objet d’aucune prescription (ce qui garantit les droits
de l’État sur ce plan).
Notons qu’après sa rencontre, samedi, avec M. Cardahi, le PDG de FTML
s’est contenté de déclarer que l’accord signé avec le ministère des Télécommunications
était « équilibré ».
Signalons, enfin, que dans une déclaration à la presse faite hier, l’ancien
Premier ministre, Selim Hoss, a critiqué la teneur des accords de transfert
de propriété signés par le ministre Cardahi avec FTML et LibanCell. Il
a affirmé que ces accords ne garantissaient pas les droits de l’État,
« comme le réclamait le ministre lui-même », notamment pour ce qui a trait
aux « garanties bancaires que les deux sociétés auraient dû octroyer à
l’État en vue du versement des montants qui seraient décidés par les tribunaux
d’arbitrage ». M. Hoss a, d’autre part, déploré le fait que le gouvernement
ait renoncé à son droit d’émettre de nouveaux mandats de recouvrement
pour les infractions aux contrats en BOT à partir de l’année 2000 (les
mandats de recouvrement de 600 millions de dollars émis par le gouvernement
couvrent les infractions jusqu’en 1999). M. Hoss souligne qu’en renonçant
aux garanties bancaires (portant sur les 600 millions de dollars) et aux
nouveaux mandats de recouvrement, le gouvernement a ainsi bradé non moins
de 1,2 milliard de dollars.
5 & 6 Décembre
2002
Marseille
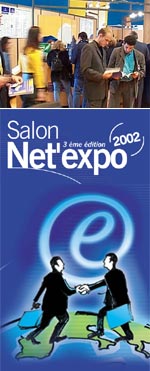
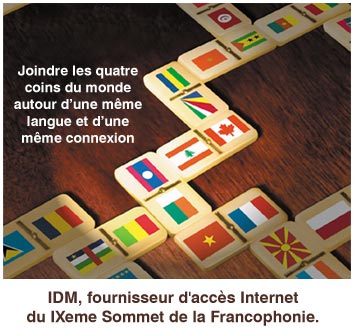
18 Octobre:
Intervention du Ministre des Télecoms Libanais au FFA
Privatisation : Le processus
sera amorcé fin décembre-début janvier Le marché des télécoms atteindra
3 milliards de dollars
Dans le cadre des Assises économiques francophones,
le panel sur les opportunités d’investissements au Liban a été l’occasion
hier tant pour le ministre des Télécommunications, Jean-Louis Cardahi,
que pour le secrétaire général du Conseil supérieur de la privatisation,
Ghazi Youssef, et le conseiller du ministre de l’Énergie et de l’Eau,
Georges Kamar, de dresser un état des lieux de la privatisation au Liban.
Une seule chose est certaine et a fait l’unanimité des intervenants :
le processus sera amorcé fin décembre 2002-début janvier 2003. Le ministre
des Télécoms, Jean-Louis Cardahi, a affirmé que la privatisation n’est
pas une cession d’actifs par l’État. Il s’agit d’un transfert de la gestion
de certains services du secteur public au secteur privé en respectant
les règles du marché et la libre concurrence entre les sociétés. Il a
annoncé que les décrets d’application de la loi sur les télécoms seront
promulgués avant la fin de l’année, ce qui permettra la création de la
société « Liban Télécom » et de l’instance de régulation. « Le gouvernement
lancera dans les prochains jours des enchères publiques internationales
pour la conversion en licences des contrats en BOT de la téléphonie mobile
», a-t-il dit, ajoutant que « les licences, qui seront accordées, n’auront
pas un caractère monopolistique. Toute entité souhaitant obtenir une licence
pourra le faire si elle remplit les conditions dictées par la loi ». M.
Cardahi a réaffirmé qu’il ne permettra pas la création d’un monopole du
secteur privé. « Notre objectif de la privatisation est d’assurer d’une
part la croissance du marché des télécoms, dont le volume devrait atteindre
les 2 à 3 milliards de dollars, et d’autre part la création de nouveaux
emplois, et par suite une reprise de l’économie dans son ensemble ». Les
revenus du secteur des télécoms, rappelle-t-on, se sont élevés en 2001
à près d’un milliard deux cents mille dollars. Ces revenus sont importants
et devraient être utilisés comme un outil pour améliorer la situation
financière du Trésor. En réponse à une question sur les propositions avancées
par les deux opérateurs de la téléphonie mobile avant sa nomination à
la tête du département des télécoms, M. Cardahi a déclaré que les revenus
du secteur représentent plus de 40 millions de dollars nets par mois.
« Et c’est ce qu’il faudrait prendre en considération. Partant de là,
il n’y a pas eu d’occasion ratée pour le gouvernement. »
Youssef : Accroître
les investissements étrangers
De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur
de la privatisation, Ghazi Youssef, a souligné que la privatisation au
Liban s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale touchant les domaines
politique, économique et administratif et visant à développer l’économie
en général. « La prise en charge par le secteur privé de certains établissements
publics pavera la voie à l’investissement de capitaux étrangers, qui contribueraient
à dynamiser l’économie », a-t-il dit. Le cadre légal du processus de privatisation
est déjà en place depuis mai 2000. Concernant l’Électricité du Liban,
les activités de production et de distribution sont en cours de privatisation.
L’appel de manifestation d’intérêts a été lancé ce mois, fixant au 22
novembre le dernier délai pour le dépôt des documents auprès du Conseil
supérieur de la privatisation. « La transmission, vu son aspect stratégique,
fait l’objet d’une coopération avec les pays limitrophes et restera aux
mains du secteur public. Cela n’élimine pas la possibilité d’une gestion
concessionnaire par une partie privée », a précisé M. Youssef. Les consultants
BNP Paribas sont sur le point d’achever les préparations pour lancer une
enchère publique prévue pour la fin décembre-début janvier 2003. Selon
la loi n° 462 sur la privatisation de l’EDL, l’octroi d’une licence, rappelle-t-on,
se traduit par le droit d’investissement et d’opérations pour une durée
de 50 ans maximum, la part initiale accordée au secteur privé ne dépassant
pas les 40 % des actions. Pour ce qui est du secteur de l’eau, les concessions
des Offices des eaux de Beyrouth et de Tripoli ont été approuvées par
le gouvernement et ratifiées par le Parlement. La Société Générale a été
chargée à titre de consultant d’élaborer une étude sur la privatisation
de l’eau potable et usée sur tout le territoire libanais en forme de concessions
accordées à un ou plusieurs opérateurs internationaux.
Marché peu favorable
Dans le secteur du transport, une étude préliminaire a
été effectuée par une compagnie française de consultation, la BCOM, pour
la privatisation des ports de Beyrouth et de Tripoli. Abordant le thème
de la stratégie de la privatisation de l’EDL, le conseiller du ministre
de l’Énergie et de l’Eau, Georges Kamar, a indiqué que BNP Paribas a rédigé
un rapport présentant à ce stade différentes options stratégiques. Le
Conseil des ministres a approuvé le 19/9/2002 une proposition du Conseil
supérieur de la privatisation relative à la création de deux sociétés
anonymes, l’une pour la gestion de la distribution et de la production,
l’autre pour la gestion du transport. Les activités de distribution et
de production resteront groupées au sein d’une même société. Les rapports
des consultants techniques et économiques ont démontré qu’une séparation
des activités de distribution et de production, par rapport à l’étroit
marché local, ne serait pas efficace en terme de compétitivité. La compétition
sera introduite progressivement par le régulateur. « Le gouvernement et
son consultant attendent le résultat des publications des expressions
d’intérêts, en vue de finaliser la stratégie en terme de structure juridique
et de type de transaction, en prenant en compte les propositions qui seraient
faites par les investisseurs potentiels», a dit M. Kamar, qui a assuré
que les instances concernées présenteront aux investisseurs potentiels
un mémorandum d’informations au mois de janvier 2003 et espèrent finaliser
la transaction au cours du premier semestre 2003. Georges Kamar a estimé
que la conjoncture mondiale n’est pas favorable à la privatisation de
l’EDL. « Au moins trois chocs majeurs, a-t-il dit, affectent la situation
du secteur de l’énergie. La crise en Argentine, qui a ébranlé la confiance
des investisseurs dans les marchés émergents, la baisse des marchés boursiers
et la réorientation des grands groupes européens (ED, ENEL...) et enfin
l’effondrement d’Enron. » M. Kamar a souligné par ailleurs que les problèmes
du Moyen-Orient posent la question de la sécurité de l’investissement.
« Mais le Liban demeure attractif pour les investisseurs arabes .» Pour
toutes ces raisons, il a qualifié de « bonne stratégie », la privatisation
par étapes de l’EDL (40 % dans un premier temps). Ce procédé permettra
au gouvernement de limiter le manque à gagner dans la conjoncture actuelle
et de donner le temps à l’investisseur stratégique pour redresser l’entreprise
et valoriser les 60 % restants des actions. Afin de rassurer les opérateurs
internationaux, le gouvernement négocie avec la Banque mondiale la possibilité
d’obtenir des garanties du type « Partial Risk Guarantees » et « Partial
Credit Guarantees ».
Liliane Mokbel
pour
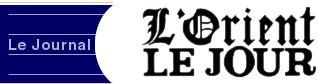
19.10.2002
2 Octobre 2002
et confirmé le 17 Octobre au FFA de Beyrouth
>>> Banques: Vers une
fédération francophone
Steve Gentili, le président de la Bred-Banque populaire et président international
du FFA (Forum francophone des affaires),
prépare dans la plus grande discrétion le lancement de la fédération internationale
des banques et institutions financières francophones.
Il réunira cinq cents chefs d’entreprise lors du sommet des chefs d’Etats
francophones qui se déroulera à Beyrouth du 18 au 20 octobre.
Une annonce sans doute destinée à faciliter la constitution d’un espace
économique et culturel francophone, projet cher à Jacques Chirac.
8 Août 2002
Le Feuilleton du Cellulaire
- Epilogue et synthèse -
Pour garantir la bonne marche
des opérations vis à vis du consommateur, il fallait trouver
un accord pour une prolongation de la gestion des deux réseaux
de téléphone cellulaire entre le 31 Août, date de
l'échéance du contrat BOT résilié par l'Etat
Libanais et le 31 Janvier prochain, date à laquelle les nouvelles
licences d'exploitation auront été attribuées.C'est
chose faite depuis ce soir et le dernier conseil des Ministres qui vient
d'entériner les accords.
Le gouvernement libanais a chargé jeudi
Cellis, une filiale de France Télécom, et LibanCell, les deux opérateurs
actuels de la téléphonie mobile, de gérer le réseau GSM jusqu'à la fin
janvier 2003 pour le compte de l'Etat, a annoncé le ministre de l'Information,
Ghazi Aridi. Cette décision est intervenue une semaine après l'adoption
en Conseil des ministres d'un plan prévoyant la récupération par l'Etat
des infrastructures et du réseau installés par Cellis et LibanCell à partir
de 1994, en vertu d'un contrat résilié unilatéralement par le gouvernement
en juin 2001.
Selon l'accord négocié par le ministre des Postes et Télécommunications,
Jean-Louis Cordahi, et entériné jeudi soir en Conseil des ministres, Cellis
et LibanCell recevront chacune dans un premier temps des compensations
de 36 à 38 millions de dollars. M. Aridi a indiqué que M. Cordahi avait
été mandaté pour poursuivre les négociations avec les deux firmes afin
de parvenir à un accord définitif. Cellis et LibanCell doivent, en contrepartie
d'un engagement de l'Etat à leur verser des indemnités qui seront calculées
par la société de consultants KPMG, présenter des garanties bancaires
de 20 M USD chacune. KMPG, agissant pour le compte du gouvernement, avait
émis une première estimation des compensations à 150 M USD pour chacune
d'elle.
Avant le 31 janvier, des appels d'offres seront lancés pour deux licences
d'exploitation sur 20 ans de la téléphonie mobile au Liban, sur la base
d'un cahier des charges établi par la banque britannique HSBC.
La récupération du réseau de la téléphonie mobile et sa privatisation
avait été au centre d'un conflit entre le président Emile Lahoud et le
Premier ministre Rafic Hariri, mais un accord a été conclu le 1er août
grâce à la médiation du président du Parlement, Nabih Berri. Les partisans
de M. Lahoud accusaient M. Hariri de favoriser les intérêts des deux entreprises
opérantes, en raison notamment de la participation de son beau-fils dans
LibanCell. Exaspéré, M. Hariri avait accusé ses détracteurs de vouloir
saboter son programme de privatisation pour l'évincer du pouvoir. Il avait
dit avoir mis fin prématurément aux contrats en juin 2001 afin de faire
taire les accusations, alors que M. Lahoud voulait que l'Etat récupère
les recettes de la téléphonie mobile, estimées à 750 M USD par an, ce
qui équivaut au moins au quart des revenus du Trésor public.
Les deux firmes ont qualifié d'"expropriation" la résiliation des contrats,
ce que M. Cordahi récuse totalement. Avant cette résiliation, l'Etat réclamait
600 M USD de pénalités, accusant Cellis et LibanCell d'avoir dépassé le
nombre autorisé de lignes, 250.000 dans le contrat, contre plus de 900.000
actuellement, ce que ces firmes contestent.
Cellis, dont 67% des actions sont détenus par France Télécom, a porté
plainte contre l'Etat libanais "pour rupture abusive du contrat" et l'affaire
a été portée devant le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale
(CCI) basée à Paris. France Télécom a également déposé un recours à Genève
devant une commission spécialisée des Nations unies contre cette expropriation
pour atteinte à la convention franco-libanaise de 1999 sur la protection
des investissements. M. Hariri a lancé des privatisations pour tenter
de réduire l'énorme dette publique, qui s'élève à 30 milliards de dollars,
soit 180% du Produit intérieur brut (PIB).
5 Août 2002:
Un Consortium Franco-libanais
en charge de la construction
du barrage du Haut-Kesrouan
Après 45 ans d’attente, le projet de construction
d’un barrage à Chabrouh, dans les hauteurs du Kesrouan, est entré désormais
dans le domaine du réel.
Lors d’une cérémonie en grande pompe, le chef de l’État, Émile Lahoud,
a donné le Samedi 3 août le coup d’envoi aux travaux de réalisation
du projet, pris en charge par le consortium franco-libanais
Dumez-Moawad-Eddé. Le barrage est prévu pour emmagasiner près
de 8 millions de mètres cubes d’eau par an, de sorte que les cazas du
Kesrouan et du Metn pourront bénéficier d’un approvisionnement en eau
potable de 60 000 mètres cubes par jour, et ce jusqu’en 2025. S’exprimant
lors de la cérémonie, M. Lahoud a souligné que la crise économique ne
signifiait nullement l’arrêt des projets productifs et assuré que l’État
était soucieux de développer les régions défavorisées du pays. L’inauguration
a été l’occasion pour les conseils municipaux de plusieurs localités du
Kesrouan de mobiliser tous leurs moyens pour réserver un accueil chaleureux
au chef de l’État, dont le convoi a effectué plusieurs haltes sur la route
de Chabrouh.
Cellulaire(suite)...
BEYROUTH, 5 août (Reuters) - Les deux opérateurs
de téléphonie mobile du Liban ont convenu d'entamer des discussions lundi
à propos de la gestion des réseaux mobiles du pays pour le compte de l'Etat
en prélude à une privatisation cruciale pour réduire un endettement public
de 28,8 milliards de dollars. "Ils ont convenu de négocier aujourd'hui
et demain", a confié une source ministérielle, qui s'est dite optimiste
quant à l'issue des discussions, tout en ajoutant qu'en l'absence d'accord,
le gouvernement pourrait trouver un troisième intervenant pour administrer
les réseaux dans l'intervalle. Cellis, une filiale de France Télécom et
LibanCell ont reçu en 1994 des licences de dix ans mais ils nourrissent
un contentieux avec Beyrouth au sujet notamment d'amendes pour non respect
présumé des contrats. Une porte-parole de Cellis a confirmé que les discussions
débuteraient lundi et des sources de LibanCell ont dit qu'il participerait
aussi à ces discussions. Le gouvernement a rompu les contrats l'an passé
dans la prévision d'une privatisation mais les deux opérateurs ont continué
de fournir leurs services, anticipant un dédommagement pour cette rupture
et le règlement d'autres contentieux juridiques. Des sources ministérielles
ont dit que Beyrouth proposait que les deux opérateurs gèrent les réseaux
jusqu'au 31 janvier 2003. Le ministre de l'Information Ghazi al-Aridi
avait avancé la semaine dernière la date du 31 août 2003.
A suivre...
2 Aout 2002:
Le Point sur le Dossier "Cellulaire"
Après de multiples rebondissements et tergiversations sous forme
d'imbroglio juridico-politique, il semble qu'à tout juste un mois
de l'échéance, une " ligne" définitive
ait été trouvée sur le chaud dossier de l'été:
"Le contrat en BOT avec Cellis et LibanCell vient à expiration le
31 août, date à laquelle le secteur de la téléphonie mobile devient propriété
de l’État, les recettes revenant entièrement au gouvernement. Dans l’attente
de la privatisation, qui devrait intervenir d’ici au 31 janvier 2003,
la gestion du réseau sera assurée, pour le compte de l’État, par Cellis
et/ou LibanCell ou, à défaut, par une autre entreprise internationale."
Voilà l'implication concrète pour l'utilisateur dans les...5
mois qui viennent.Au-delà, la visibilité est bien faible
d'autant que des recours d'arbitrage international ont été
entamés par les opérateurs actuels.Alors, d'autres rebondissements
probables sont susceptibles de se produire en fonction de la suite donnée
à un nouvel appel d'offres international.
L'encre et la salive n'ont certainement pas fini de couler...
JMD

22 Juin 2002:

Lancement
de la Procédure de la Détaxe au Liban
>>>Notre Dossier complet

25 Mai 2002:
Mr Jean-Claude Boulos, Nouveau
président de l'IAA,
l'Agence Internationale des Agences de la Publicité

JC Boulos entre Fouad Siniora et Issam
Farès
Nous ne pouvons que nous réjouir de l'élection
pour deux ans à la tête de l'IAA, de Mr Jean-Claude Boulos.II
est le troisième libanais élu comme responsable de cette
organisation professionnelle très représentative au niveau
international.Il est actuellement dirigeant de l'agence Inter-Régies,
affilié au groupe international Saatchi&Saatchi, et a été
PDG de Télé-Liban à la fin des années 90.
Le congrès de l'Agence Internationale de la Publicité vient
de réunir à Beyrouth, pendant trois jours, quelques 900
participants de 42 pays. Il a en outre récompensé Carlos
Ghosn, Franco-brésilien d'origine libanaise, et PDG de Nissan,
comme patron de l'année, ce qui est un choix logique compte tenu
des remarquables performances de son groupe dans l'environnement économique
mondial actuel.
Jean-Claude Boulos a fixé dès
son élection le développement de la publicité dans
le monde arabe comme un des premiers objectifs de son mandat, compte tenu
de la taille de ce marché qui présente l'intérêt
de combiner un énorme potentiel et des valeurs communes.
Voilà donc une bonne nouvelle pour le
Liban et la Francophonie du monde des affaires quand on connait l'attachement
du nouveau Président de l'IAA à la langue française
et à son utilisation dans le monde de la communication partout
ou celui-ci peut se justifier.
Jean-Michel Druart
Lien: Site
Web de la section libanaise de l'IAA
Avril
2002 :
Tensions au Sud, dégradation
de la note de la dette*, Hariri chez Bush le Mercredi 17 Avril: le risque
monétaire s'accroit dangereusement !
*Dette - Standard and Poor’s dégrade la note du Liban
------------
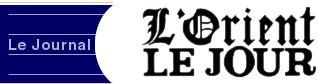
Edition du 12 Avril
L’agence de notation internationale Standard and Poor’s
a une nouvelle fois dégradé la note de la dette souveraine du Liban. La
note attribuée à la dette à long terme est ainsi passée à B- contre B
auparavant. Et la dette à court terme a été classée C au lieu de B. Ces
appréciations ont été assorties d’une évaluation négative des perspectives.
Dans un communiqué, l’agence explique son évaluation par «les inquiétudes
en ce qui concerne la capacité du gouvernement (libanais) à inverser la
croissance du poids de la dette publique, estimée à 178 % du PIB cette
année, de façon efficace et rapide». Navaid Farooq, l’analyste chargé
du Liban au sein de S&P, ajoute : «À moins que le gouvernement mette en
place rapidement une politique budgétaire crédible, la perspective d’une
aide financière de la communauté internationale reste incertaine et la
probabilité d’une restructuration de la dette augmentera». L’agence internationale
souligne que la Banque centrale du Liban a jusqu’ici réussi à défendre
le taux de change de la livre par rapport au dollar, mais que sa marge
de manœuvre diminue à mesure que ses réserves s’érodent. «Les réserves
de la banque centrale vont probablement poursuivre leur baisse à moins
que les difficultés budgétaires du Liban soient résolues de façon décisive».
L’introduction de la TVA en 2002 et les mesures destinées à réduire les
dépenses publiques sont des pas modestes dans la bonne direction, mais
ils sont insuffisants pour réduire le déficit budgétaire très élevé qui
est estimé à 16,8 % du PIB pour 2002, poursuit le communiqué. «Comme par
le passé, la dynamique politique complexe du Liban rend très difficile
l’adoption de mesures politiques décisives». Standard and Poor’s met aussi
en doute la capacité du gouvernement à satisfaire ses besoins de financement
budgétaires pour 2002 et 2003 sans recourir à une hausse significative
du service de la dette. La capacité de financement du secteur bancaire
libanais est liée à la croissance des dépôts. Or celle-ci a diminué progressivement
et sera minime cette année, poursuit S&P. «Face aux contraintes financières
intérieures croissantes, la mise en vente des actifs et l’obtention d’un
soutien financier international deviennent de plus en plus importants
pour permettre au gouvernement de gagner du temps afin d’adopter des mesures
d’ajustement structurel. La détérioration de l’environnement géopolitique
régional accroît la vulnérabilité de l’économie libanaise et rend les
réformes d’autant plus urgentes».
«La notation du Liban restera sous pression jusqu’à ce qu’une correction
budgétaire soit assez importante pour inverser la croissance de la dette»,
conclut M. Farooq. «D’ici à la fin de l’année, il est crucial que le gouvernement
s’assure des recettes de privatisations substantielles et satisfasse les
conditions pour la réunion d’une deuxième conférence internationale des
donateurs à Paris». Selon un opérateur libanais, les marchés financiers
n’ont pas spécialement réagi hier au communiqué de Standard and Poor’s.
Sur le marché obligataire, la décote enregistrée par certains des principaux
eurobonds émis par la République libanaise tient déjà compte de la détérioration
de la situation. Certaines obligations enregistrent une décote de 5 à
6 % tandis que pour d’autres, la décote atteint les 18 %.
Solidere : Une
émission structurée par une filiale de la Bemo:
Succès de la première opération de titrisation au Moyen-Orient
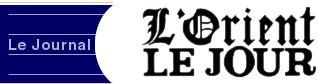
édition du 4 Avril 2002
--------------------------------
La première opération de titrisation du Moyen-Orient a été réalisée
avec succès à Beyrouth pour le compte de Solidere,
a annoncé la Bemo Securitisation, une filiale de la Banque
européenne pour le Moyen-Orient. Riad Obegi, président de Bemo Securitisation,
et Maher Beydoun, vice-président de Solidere, ont signé hier l’accord
scellant l’opération. Celle-ci a consisté en la création d’un fonds, baptisé
Indigo Trust Fund, qui a acheté des actions Solidere avec une option de
vente et émis en contrepartie des obligations à capital garanti pour un
montant total de six millions de dollars. La maturité de ces obligations
est de trois ans et le taux d’intérêt annuel garanti, de 5,75 %. Ces obligations,
dont le montant nominal est de mille dollars, ont été entièrement souscrites,
a déclaré Jean Riachi, PDG de FFA, la société financière chargée de cogérer
la commercialisation des titres.
«L’opération est un succès car l’émission a été entièrement souscrite
malgré une conjoncture régionale particulièrement mauvaise», a-t-il expliqué.
Les souscripteurs sont essentiellement des investisseurs du Golfe ou des
Libanais de l’étranger. Il s’agit d’investisseurs intéressés par Solidere,
qui souhaitent profiter d’une éventuelle remontée du cours de son action,
sans toutefois prendre le risque d’une nouvelle baisse. L’action Solidere
A cotait 4 5/8 dollars hier soir à la clôture de la Bourse de Beyrouth.
L’obligation qui leur est proposée fonctionne selon le même principe qu’une
obligation convertible en action. À la souscription, elle vaut 1 000 dollars.
L’intérêt garanti sur trois ans est de 18,26 %, soit 5,75 % par an. Ce
qui signifie qu’en avril 2005, l’investisseur est assuré de récupérer
1 182,6 dollars ou, s’il le souhaite, d’obtenir 167 actions de Solidere.
Concrètement, si le cours de l’action Solidere est, à cette date supérieur
à 7,08 dollars (1 182,6 divisé par 167), l’investisseur a intérêt à demander
des actions, sinon, il est assuré d’avoir augmenté son capital de 18,26
%.
Montage breveté Ce produit financier n’est pas juridiquement une obligation
convertible en action, même si le principe est le même du point de vue
de l’investisseur. L’obligation est émise par un «véhicule monocédant»
(Special Purpose Vehicule), baptisé Indigo Trust Fund, qui est distinct
de la société Solidere. Ce montage financier a été imaginé et breveté
par Bemo Securitisation. Il se fonde sur la loi libanaise sur la fiducie,
en l’absence pour le moment d’une loi sur la titrisation. «La technique
que nous avons développée a reçu l’aval de la Banque du Liban, de la Bourse
de Beyrouth et de la Midclear qui agit comme dépositaire», précise Iyad
Boustany, vice-président de Bemo Securitisation. Le montage consiste à
créer un fonds qui a acheté à Solidere des actions au prix de 5,988 dollars,
ainsi qu’une option pour revendre ces actions dans trois ans au prix prédéterminé
de 7,10 dollars. En échange de ces titres, le fonds a émis 6 012 des obligations
dont la valeur nominale est de 1 000 dollars.
Ce montage vient d’un besoin de Solidere qui détenait environ cinq millions
de ses propres actions. La loi l’autorise à détenir jusqu’à 10 % de ses
titres à condition de ne pas les conserver pendant plus de 18 mois. La
société chargée de reconstruire le centre-ville a préféré ne pas vendre
directement ses titres sur le marché pour ne pas influer sur le cours
de l’action qui a déjà beaucoup chuté. Elle ne voulait pas non plus assortir
chacun des titres vendus d’une option de rachat et préférait effectuer
une seule transaction globale. C’est ce que l’opération de titrisation
a permis de réaliser. Ce montage financier a l’avantage d’offrir un produit
dont les risques sont clairement identifiés. «L’investisseur accepte un
risque structuré identifié, il évite tous les risques collatéraux qui
peuvent survenir dans d’autres opérations», explique Iyad Boustany. Dans
le cas présent, le seul risque encouru par l’investisseur porte sur la
capacité de remboursement de Solidere. Car tout le montage suppose que,
dans trois ans, si le cours de l’action reste bas, la société foncière
rachète elle-même les actions à un prix prédéterminé. «Or, ce risque n’est
pas très important au regard du bilan de Solidere», affirme M. Boustany.
Il fait valoir que l’endettement de la société ne représente que 25 %
de ses actifs tandis que le niveau de trésorerie dépasse les 100 millions
de dollars, alors que l’option d’achat porte sur environ sept millions
de dollars.
Étant donné le succès de la première opération de titrisation, Solidere
envisage d’en effectuer d’autres pour le reste des actions qu’elle détient
dans son portefeuille. La société foncière prépare en outre avec la Bemo
Securitisation une autre opération d’une envergure beaucoup plus grande,
puisqu’elle portera sur un montant avoisinant les 100 millions de dollars.
Il s’agira de titriser une partie des créances détenues par Solidere qui
a vendu des terrains à crédit sur cinq ans.
Février 2002 :
Accord de Coopération touristique
entre le Liban et la Syrie

|
Les Ministres libanais et Syriens du tourisme ont signé le 7 Février
en présence de nombreux hauts responsables des deux cabinets ministériels, un
accord de coopération renforcée entre les deux pays.
Cet accord qui concerne la période de 2002 à 2004 vise à coordonner et à promouvoir
non seulement les activités touristiques mais aussi les échanges d'expertise et
les projets d'investissements. Il comporte bon nombre de mesures opérationnelles
et concrètes visant à faciliter la promotion de la zone entant qu'entité géographique
cohérente vis à vis des touristes potentiels comme l'illustre la complémentarité
des nombreux sites archéologiques des deux pays par exemple.
On notera par ailleurs que cet accord octroie une part non négligeable aux mouvements
de la jeunesse entre les deux pays ainsi qu'aux activités touristico-sportives.
Bon nombre de circuits proposés à l'étranger par les Tours-opérators associent
déjà les deux pays et Mr Karam, ministre Libanais du Tourisme Libanais a émis
le souhait que la Jordanie y soit également associée dans un proche avenir. Il
faut dire que ce pays est lui aussi fréquemment inclus dans les programmes combinés
de visites au Proche- Orient.
Si certains affirmeront que cet accord s'inscrit dans la suite logique des accords
de coopération entre le Liban et la Syrie depuis la signature en 1991 de leur
traité-cadre de fraternité, de coopération et de coordination, d'autres y verront
l'opportunisme d'un des acteurs visant à bénéficier de la tradition et de la grande
expérience en matière de savoir-faire touristique de l'autre... Qu'importe finalement,
tant que l'amélioration de la qualité du service profite en priorité aux touristes
dont l'approche est de plus en plus internationale, et surtout que le climat politique
général de la région ne fasse pas que toutes ces démarches louables ne restent
lettres mortes dans la réalité.
Jean-Michel DRUART
et aussi...
Vers
la fin des Monopoles au Liban, mais sous protection...
dans

Alors que l'on
vient d'apprendre que le projet de fusion entre la Banque Libano-Française
et la Banque Saradar ne pouvait pour l'instant aboutir faute d'accord sur la parité
à retenir notamment suite à un désaccord sur la valorisation
de Saradar, voilà que les premiers résultats du secteur commencent
à arriver,
en droite ligne avec notre analyse du mois dernier...
Lire
Janvier 2002
:
le secteur bancaire reste le phare de l'économie
Libanaise mais n'échappe pas à la morosité
Cette période de
l'année est généralement propice aux bilans et perspectives.Le
secteur bancaire et financier n'échappe particulièrement
pas à cette tradition.
Alors que la Banque du Liban vient d'officiellement annoncer que ses réserves
de changes avaient diminué de 20% au cours de l'année 2001
en raison essentiellement de la vente de Dollars pour soutenir la Livre,
un rapport du magazine Banker revèle que seules huit banques libanaises
font partie du Top 100 parmi les Banques Arabes en terme de fonds propres
en l'an 2000.
Cela signifie clairement une stagnation de l'activité du secteur
au Liban et une régression dans l'activité de prêts
et d'emprunts.
La banque de la Méditerranée
est la mieux classée en 35ème position.
Suivent la Banque Byblos, 49ème, la BLOM, 60 ème, la Banque
Audi, 62 ème, la Fransabank, 64ème, la Banque Libano-Française
au 70 ème rang, le Crédit Libanais 84ème et enfin
la Banque of Beirut and Arab Countries 98ème.
Si les 8 banques libanaises
représentent ensemble un total de capitaux propres pour à
peine 450 millions d'US$, le Top 3 des banques classées qui sont
Saoudiennes représentent à elles seules plus de 20 milliards
d'US$ de capitaux propres!
L'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis se taillent
la part du lion entête de classement et le rapport stipule que les
évènements du 11 Septembre aux Etats-Unis ont finalement
eu un impact limité sur le secteur bancaire, surtout à court
terme.
2001 aura vu la poursuite
du mouvement de concentration dans le secteur mais également de
l'érosion des profits et des cours de bourse du secteur qui malgré
sa solidité n'échappe pas à la stagnation de l'économie.La
Banque Libano-Française est sur le point d'absorber la Banque Saradar
et la Byblos Bank étudierait sérieusement la reprise des
activités du Crédit Lyonnais Liban.
Gageons donc que le pire
serait derrière nous et que le secteur sera tout de même
le mieux armé pour accompagner un éventuel redressement
de l'économie que tout le monde appelle de ses voeux.Néammoins,
la problématique de la Livre Libanaise reste d'actualité
donc le bien-fondé d'une purge préalable qui signifierait
flottement et dévaluation.
Catastrophe? Pas si sur
car le Liban n'est pas l'Argentine...et même si son secteur bancaire
n'a plus son lustre d'antan malgré ses gros efforts de restructuration
et d'adaptation, il n'en conserve néammoins de sérieux atouts
pour apporter une solide contribution à un scénario de relance
de l'économie en assumant logiquement son rôle responsable
et exemplaire de moteur.
 Décembre 2002:
Décembre 2002:
le temps des fusions...dans la Banque et l'Internet
Vers une Fusion
des Banques Libano-Française et Saradar?
BEYROUTH, 11 décembre (Reuters) - Deux banques libanaises,
qui comptent des groupes étrangers parmi leurs actionnaires, discutent actuellement
en vue d'une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des banques les
plus diversifiées du Proche-Orient, apprend-on mardi de source financière.
Selon ces sources, la Banque Libano-Française, dont 51% appartiennent au Crédit
Agricole , négocie pour reprendre la Banque Saradar, où International Finance
Corporation et la Banque Nationale du Canada détiennent une participation minoritaire.
"Il semblerait que l'accord soit en cours de finalisation", a dit à Reuters un
responsable bancaire. "La banque privée et la banque d'investissement sont les
spécialités de la Banque Saradar et viendront en complément de l'activité de la
Banque Libano-Française, plus tournée vers la banque aux entreprises et aux particuliers",
a-t-il ajouté.
Aucun des deux établissements n'a fait de commentaires. La banque centrale du
Liban incite les 65 banques libanaises à fusionner les unes aves les autres.
Si la fusion entre la Banque Saradar et la Banque Libano-Française va à son terme,
ce serait la première fusion entre deux banques comptant parmi les dix principales
du Liban.
La Banque Libano-Française affiche un total des actifs de $3,4 milliards et un
rapport de fonds propres à l'actif de 5,7%. Elle a dégagé un bénéfice de $37 millions
l'an dernier contre $10,7 millions pour Saradar. Saradar avait un total d'actifs
de $1,7 milliard fin 2000 et un rapport fonds propres/actifs de 4,4%.

Fusion annoncée de
Data Management et Inconet :
le Plus Grand Fournisseur d'Accès Internet au Moyen-Orient
voit le Jour
|
BEYROUTH, 12 Décembre
( Naharnet )-Les Fournisseurs d'accès Internet Data Management et Inconet
ont fusionné mercredi donnant naissance au plus grand fournisseur d'accès
Internet au Liban et au Moyen-Orient.
Un communiqué de presse a indiqué que Lebanon Invest a orchestré et arrangé
la fusion. La nouvelle entité opérera sous le nom de Inconet Data Management
(IDM) et devrait voir le jour le 2 janvier 2002. Elle sera par ailleurs
la propriété à hauteur de 62% du groupe Inconet et à hauteur de 38% du
groupe Data Management. IDM servira un nombre important de Libanais et
mettra à leur disposition pas moins de 3000 lignes téléphoniques et 14
points de ventes couvrant la totalité du territoire libanais. Soixante
techniciens spécialisés et un lien satellite à l'Internet assureront le
bon fonctionnement du réseau Internet a ajouté le communiqué de presse.
"Nous sommes enthousiasmés par cette fusion. La satisfaction de la clientèle
est la clef de notre succès. IDM sera au service de la clientèle et lui
offrira une qualité optimale", a indiqué Maroun Chammas, directeur général
de Data Management. De son côté docteur Habib Torbey, président d'Inconet,
a noté que "la fusion entre les deux plus importants fournisseurs d'accès
Internet pave la voie au développement du secteur de l'Internet au Liban
et au Moyen-Orient".
Novembre 2001:
L'économie libanaise sous pression...
Déjà
le Printemps 2001 avait fait l'objet des plus folles rumeurs concernant
la monnaie nationale: elle ne pourrait pas passer l'été
au taux de 1500LL pour un Dollar.
Le Liban n'étant pas à un miracle près, une réunion
à Paris et quelques belles promesses de réformes économiques
et d'orthodoxie budgétaire ont permis que rien ne se passe et la
parité a pu être maintenue non sans quelques interventions
de la Banque du Liban.
Cependant,
nous voilà déjà au coeur de l'Automne et cela signifie
t-il que, malgré le réchauffement de la planète,
la Livre pourra passer l'hiver au chaud?
Le 11 Septembre est passé par là et la tenue avant la fin
de l'année d'une nouvelle conférence baptisée Paris2,
maintes fois évoquée et reportée semble bien avoir
du plomb dans l'aile.
Malgré le soutien moral et la bonne volonté affichée
par Paris, il semble bien délicat, dans l'environnement mondial
actuel, d'organiser cette réunion de sauvetage dans les plus brefs
délais.
En
effet, Beyrouth se retrouve, malgré lui, placé au carrefour
de la politique et de l'économie: il est manifeste que les puissants
lobbys d'Outre-Atlantique s'organisent depuis Septembre pour bombarder
le Liban de rapports autant désobligeants que lucides sur le plan
économique:
Ne
revenons pas sur le placement, depuis plusieurs mois, du pays dans la
liste noire du GAFI sur le blanchiment de l'argent sale.
A la mi-Octobre , c'est l'agence de notation Standard&Poors
qui intègre le Liban dans une liste de 15 Pays dont le système
financier est en proie à des tensions ou qui présentent
des signes annonciateurs de difficultés.Parmi ces pays figurent
ni plus ni moins, les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, l'Argentine,
la Turquie et l'Egypte.Quel honneur d'être le petit poucet d'une
telle liste ou sont également épinglés parmi les
petites nations l'Islande ou Chypre!
A la fin Octobre, c'est l'éminent FMI, Fond Monétaire
International, qui met en relief l'importance du cumul des déficits
des finances publiques, 24% du PIB en 2000 et encore près de 23%
en 2001 malgré les premiers efforts entrepris, mais aussi la détérioration
des réserves de changes et surtout l'augmentation du service de
la dette qui passera de 153% du PIB en 2000 ( dont 46% en devises ) à
176% probables en 2001.Ces éléments s'inscrivent, qui plus
est, dans un environnement économique mondial particulièrement
difficile et dégradé.
En
2000, la croissance libanaise fut nulle et le FMI commença à
sommer gentillement le Liban d'amorcer sérieusement et en profondeur
une restructuration budgétaire et de réduire les taux d'intérêt
afin de réduire la dette publique.
Certes, il a pris note d'un élan volontaire dans
la bonne direction en 2001 mais il faut avouer que le taux de croissance
atteindra peut-être 1%, que le programme des privatisations annoncées
a pris bien du retard et que la mise en place de la perception d'une TVA,
Taxe sur la Valeur Ajoutée, destinée à fournir de
nouvelles ressources à l'Etat ne doit commencer qu'au premier trimestre
de 2002.
Nous
ne pouvons nous empêcher de coupler ces considérations purement
économiques à la situation politique délicate du
Liban qui demeure sans aucun doute, particulièrement de la part
des Etats-Unis, sous observation notamment en matière de terrorisme.
Le scénario d'un chantage consistant à exiger
une purge économique avant d'envisager un programme sérieux
d'aide internationale ne peut donc être occulté.
Et dans le cadre d'une telle purge, une question refait
surface:
Comment pourra t-on éviter une dévaluation de la Livre Libanaise
qui permettrait une réduction mécanique de la dette publique
pour pouvoir repartir sur des bases assainies?
Certains
relativisent l'impact réel d'une telle mesure: même si l'économie
est hautement dollarisée - sans doute au delà des 70% à
ce jour - il ne faut pas minimiser le fait qu'elle toucherait en premier
lieu les couches sociales les plus défavorisées risquant
ainsi d'entrainer une instabilité sociale déjà latente.
Et
voilà comment pourrait se refermer le piège insidieux sur
le Liban à travers une arme bien plus discrète que les bombes
sur l'Afghanistan mais au moins autant efficace...Une fois de plus, sera
t-il suffisant de s'en remettre à JC ( Jacques Chirac ou Jésus-Christ,
à vous de choisir! ) pour pouvoir contourner l'obstacle?
Le
report du sommet de la Francophonie, outre les retombées économiques
directes et indirectes qu'il aurait du générer dès
l'Automne 2001, empêche un crédit d'image dont le Liban aurait
pu bénéficier sur le plan international; les satanés
évènements du 11 Septembre en ont décidé autrement
et ont différé l'évènement d'un an, Inch Allah!!
Il
faudra que la communauté francophone, hors sommet, se mobilise
cette fois au sommet pour sortir cette nouvelle épine du pied du
Liban.
En a t-elle vraiment la volonté et surtout les moyens dans les
circonstances actuelles?
Les semaines et les mois qui viennent nous aideront certainement
à y voir plus clair.
Jean-Michel DRUART
2.11.2001
|


![]()


![]()
![]()

![]()

![]()
![]()