|
La
violence dans les campus, vécue comme une fatalité
par les étudiants, suscite la grande inquiétude
des responsables universitaires. Trois étudiants, le recteur
de l’USJ, le père René Chamussy, et un sociologue,
Abdo Kahi, se penchent sur ce phénomène qui éclate
régulièrement à l’occasion des élections
estudiantines et qui va en augmentant chaque année.
Le dossier complet d'Anne-Marie El Hage
Paru dans L'Orient-Le Jour du 6 Décembre
2008
|
|

Depuis le coup d’envoi des élections
estudiantines dans les universités, la violence verbale
et parfois même physique a repris de plus belle entre
les étudiants, pour la plupart politisés à
outrance et appartenant à diverses parties. Le moindre
événement à caractère politique
tourne à la confrontation dans les campus. On ne sait
plus dialoguer, mais on s’invective, on s’insulte.
Puis on en vient aux mains. On ne manque pas non plus d’utiliser
des bâtons, des pierres, voire des poings américains.
Les chaises et les poubelles volent aussi inévitablement.
Les adversaires politiques deviennent alors de véritables
ennemis et se refusent mutuellement, dans une volonté
clairement exprimée d’écarter l’autre.
Même à l’Université libanaise où
les élections estudiantines ont été suspendues
cette année au vu de la grande tension qui règne
entre les étudiants, la violence s’est manifestée
pas plus tard que la semaine dernière. Il y a deux jours,
c’est à l’Université antonine qu’un
accrochage a été évité.
Ces incidents qui se multiplient ont poussé les recteurs
des cinq universités catholiques du Liban (Université
Saint-Joseph, Université Saint-Esprit de Kaslik, Université
Notre Dame de Louaizé, Université antonine et
Université La Sagesse) à tirer pour la première
fois la sonnette d’alarme (voir L’Orient-Le Jour du
4 décembre 2008). Les recteurs dénoncent ces incidents
qu’ils qualifient de graves et expriment leur attachement
aux valeurs de liberté, de pluralité et de diversité
des opinions, tout en espérant prendre part à
la reconstruction d’une société libanaise
plus pacifiée, plus solidaire, plus unifiée. De
son côté, l’USJ a saisi le conseil de discipline
suite aux violences qui se sont déroulées à
Huvelin le jour de la commémoration de l’assassinat
de Pierre Gemayel et décidé de suspendre toutes
les activités à caractère politique, sur
tous les campus et dans tous les centres régionaux, à
la demande des amicales d’étudiants, précise
le communiqué du recteur, le père René
Chamussy.
Pourquoi cette violence éclate-t-elle aujourd’hui
dans les universités ? Qu’en pensent les jeunes,
impliqués eux-mêmes dans cette spirale ?
Baisse
de la citoyenneté
«
Il n’y a plus d’échanges civilisés
entre nous », constate le délégué
du 14 Mars au sein de la faculté de sciences politiques
de l’USJ, Nicolas Farah. L’étudiant raconte
qu’il a été agressé, insulté,
fin novembre, lors de la journée commémorant
l’assassinat de Pierre Gemayel, alors qu’il se «
tenait de côté » et tentait « de
calmer les esprits », selon ses propos. Il précise
toutefois qu’il n’a pu s’empêcher de
répliquer et d’insulter lui aussi un chef politique
de l’opposition. « Les menaces, les atteintes à
notre dignité sont si flagrantes que nous ne pouvions
pas nous empêcher de riposter », ajoute-t-il,
estimant que « ces confrontations prennent des tournures
personnelles ». « Les sensibilités sont
exacerbées, on s’éloigne les uns des autres
et cela ne fait qu’empirer depuis trois ans »,
observe-t-il encore. Et d’ajouter que d’un autre
côté, « on assiste à une nette baisse
au niveau de la citoyenneté, de la construction d’une
nation et des relations entre étudiants », même
si, tient-il à préciser, « nous parvenons
à maintenir des contacts amicaux avec nos adversaires
politiques, dès lors que la politique est absente des
discussions ».
Nicolas Farah tient la direction de l’université
pour responsable de l’éruption de la violence
entre les étudiants à Huvelin, car il estime
que la loi qu’elle a instaurée concernant la nécessité
de recueillir la signature des cinq délégués
des facultés pour l’organisation d’un événement
politique « pousse les étudiants à la
confrontation ». « L’université se
doit d’ailleurs d’assurer la sécurité
des élèves au sein du campus », ajoute-t-il,
affirmant que « des éléments extérieurs
à l’université se sont infiltrés
» pour participer à l’agression ce jour-là.
Nicolas Farah pointe aussi du doigt les leaders politiques
qui doivent « assumer leur part de responsabilité
» dans la violence entre étudiants. « L’université
est un miroir. Elle ne fait que répercuter ce qui se
passe à l’extérieur », conclut-il.
Le
droit de veto pour embêter l’autre
De son côté, le délégué
du CPL à la faculté de droit de l’USJ,
Marc el-Hage, observe que la violence entre étudiants
découle de l’entêtement de chaque partie,
de la recrudescence de la propagande et de l’exacerbation
des tensions.
Il dénonce aussi le refus des Forces libanaises et
des Kataëb de la présence chiite à l’USJ,
« une université qu’ils considèrent
exclusivement chrétienne ». « C’est
une logique fausse. L’USJ doit être à l’image
du pays », dit-il à ce propos.
Marc el-Hage raconte que les jeunes du CPL ont bien tenté
de s’interposer entre les deux parties adverses pour
éviter les débordements, le jour où les
Kataëb et les FL ont voulu commémorer l’assassinat
de Pierre Gemayel à Huvelin. « Nous n’avons
pas réussi à empêcher la violence d’éclater
», remarque-t-il, constatant que « le langage
de la force l’a finalement emporté ».
L’étudiant déplore cependant l’interdiction
des événements à caractère politique
au sein de l’université. « Durant neuf mois,
il n’y a ni table ronde ni dialogue. Et pourtant, c’est
la façon la plus saine de discuter et d’exprimer
sa peur de l’autre », dit-il. Critiquant l’instauration
du droit de veto pour permettre ou empêcher l’organisation
d’un événement, il observe que «
chaque partie utilise son droit de veto pour empoisonner l’autre
». Il tient toutefois à préciser que les
étudiants parviennent à organiser ensemble des
activités à caractère social, notamment
la journée de l’Indépendance ou celle du
sida, « des journées réussies qui ont
permis l’échange et l’entente entre étudiants
au sein des facultés ». D’ailleurs, précise-t-il,
« les tensions entre étudiants se limitent aux
périodes des élections. Le reste du temps, tout
se déroule normalement ».
Le
dialogue, sollicité par les étudiants
À son tour, Ali el-Amine, délégué
du mouvement Amal à la faculté de droit de l’USJ,
minimise les incidents qui se sont déroulés
au campus des sciences sociales de l’université.
« Ce n’est pas de la violence, c’est plutôt
de la publicité », remarque-t-il, tout en qualifiant
les incidents entre étudiants de « frictions
».
« C’est durant les élections que l’ambiance
se dégrade le plus », confirme-t-il, évoquant
les slogans, les idées importées de l’extérieur
du campus qui attisent les tensions. Le jeune homme tient
à préciser que les 3 000 étudiants du
campus se connaissent tous et que des amitiés existent
entre étudiants d’appartenances différentes.
« Nous nous rencontrons parfois même à
l’extérieur de l’université à
l’occasion de soirées, ou pour dialoguer et calmer
les choses au niveau politique », observe-t-il. «
Nous organisons aussi ensemble certaines activités
concernant des sujets qui ne fâchent pas. Mais les choses
évoluent à petits pas, constate-t-il. Il n’y
a pas encore de liens continus. »
Ali el-Amine blâme toutefois l’université
qui « interdit le dialogue entre étudiants et
les empêche de s’entendre ». « Dans
le temps, il existait des tables rondes, des rencontres avec
des hommes politiques, mais aujourd’hui, ce genre d’activité
est interdit à l’intérieur du campus, ce
qui génère un certain stress entre étudiants
», regrette-t-il. « La direction prétend
que les étudiants ne savent pas se contrôler,
or chaque partie veut s’exprimer », insiste-t-il.
Et de préciser que les étudiants font pression
pour que cet interdit soit levé.
L’étudiant tient à mentionner que lui-même
et le mouvement qu’il représente sont contre la
violence. « Tout le monde est d’ailleurs contre
la violence, mais les choses ne sont pas toujours sous contrôle
», estime-t-il, préconisant l’engagement
des amicales d’étudiants dans certaines initiatives
qui rapprocheraient les jeunes. « Il faudrait aussi
que les étudiants soient eux-mêmes porteurs d’idées
qu’ils véhiculent à l’extérieur
de l’université », souhaite-t-il, insistant
que tout doit commencer par le dialogue.
Un dialogue tellement sollicité, mais que les étudiants
ne semblent pas savoir comment engager.
|
 
Les germes d’une guerre
civile rampante,
selon le père René Chamussy

Le
recteur de l’Université Saint-Joseph, le père René
Chamussy (en photo ci-dessus),
fait part de sa forte inquiétude concernant la violence verbale
des étudiants qui peut rapidement dégénérer.
Une violence qui s’exacerbe à l’issue des élections
estudiantines, qui se réveille à chaque événement
à caractère politique et qui pousse le recteur à
évoquer le danger d’une guerre civile rampante.
« La violence entre étudiants est la répercussion
sur les campus du conflit qui existe au niveau national », observe
le père René Chamussy, précisant que les campus de
l’USJ ont toujours été un terrain favorable à
l’engagement politique. « La figure que prend cet engagement
est telle que ce qui est haine et violence l’emporte sur le rationnel,
le sensé et l’approche de l’autre », constate-t-il.
S’il estime normal que les gens soient différents politiquement,
le recteur remarque qu’il ne s’agit plus aujourd’hui de
différences politiques, mais « de partis fermés sur
eux-mêmes et de partisans manipulés par leurs mandants ».
Il explique alors que « c’est à l’occasion des
élections estudiantines, lors de l’attente des résultats,
que les groupes se chauffent et que les affrontements éclatent
». « Les coups de fil que les étudiants reçoivent
de l’extérieur de la part des petits chefs de partis ne sont
pas étrangers à ces débordements », note le
recteur.
Comme cela se déroule dans le climat politique actuel, que le recteur
qualifie de catastrophique, « les universitaires s’affrontent
pour s’affronter, parce qu’ils ne se supportent pas, parce qu’il
y a des résurgences confessionnelles qui ressortent », observe
le père Chamussy. Et de constater que « la violence verbale
se développe et se manifeste sur le plan de l’appartenance
clanique politique ou sur le plan confessionnel ». « Cela
est intolérable. On ne peut l’admettre, car cela va contre
les valeurs profondes de l’université », estime-t-il.
Le père Chamussy indique à ce propos que l’USJ accueille
des étudiants de toutes les confessions et de toutes les communautés
religieuses. Il précise que durant l’année universitaire
2007-2008, 67,2 % de ses 10 000 étudiants étaient de confession
chrétienne et 32,7 % de confession musulmane. Il ajoute que le
tableau est presque identique cette année, même si les dernières
statistiques n’ont pas encore été publiées.
Le recteur insiste aussi sur le fait que l’université est
le lieu où les étudiants doivent apprendre à vivre
« en citoyens et en démocratie ». C’est d’ailleurs
dans cette optique que sont organisées les activités d’engagement
social ou culturel, comme l’Opération 7e jour, dans lesquelles
les étudiants ont la possibilité de s’impliquer. Conscient
que l’interdiction des activités à caractère
politique n’est pas la solution idéale, il affirme qu’
« il n’est pas question d’autoriser, au sein des campus,
des manifestations à la gloire de tel ou tel homme politique ».
« D’ailleurs, il y a quelques années, lorsque les débats
politiques ont été autorisés, les choses se sont
mal passées et, au lieu de dialoguer, les étudiants s’invectivaient
et se battaient », se souvient le recteur.
S’interrogeant sur les raisons de cette « grave violence verbale
» entre les étudiants, « qui peut facilement dégénérer
en violence physique », le père Chamussy pointe du doigt
les partis, les mouvements, ainsi que les chefs politiques, de même
que les familles où l’on s’excite dès que la discussion
tourne autour de la politique. Il dénonce aussi « les médias
qui jettent de l’huile sur le feu », ainsi que les établissements
scolaires dont le rôle est, au même titre que les parents,
d’enseigner aux enfants le sens de la parole et du dialogue. C’est
d’ailleurs dans l’objectif de créer une cellule de dialogue
que l’USJ a mis en place le Centre de médiation ainsi qu’un
système pour canaliser la violence.
Aujourd’hui, c’est d’un œil inquiet que le père
recteur regarde la violence s’installer dans les universités
du pays. « C’est inquiétant. C’est une guerre civile
rampante », conclut-il, refusant toutefois de perdre espoir.
|
 
Aux
yeux du sociologue Abdo Kahi, les jeunes ne font pas de politique, mais
de l’antipolitique
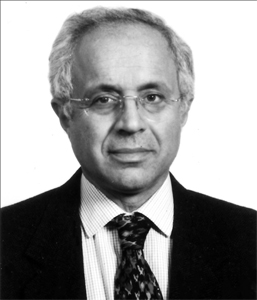
C’est
avec grande sévérité que le sociologue Abdo Kahi
juge la violence entre les étudiants. Une violence qui vient
du clanisme parce que l’appartenance sauvage et le suivisme se
défendent par le sang.
« Le problème des universités, c’est qu’elles
ne forment plus les jeunes à la vie politique ou à la
citoyenneté. C’est plutôt de l’antipolitique
que font aujourd’hui ces étudiants », dénonce
le sociologue. Abdo Kahi explique que dans les universités du
pays, on défend aujourd’hui les intérêts des
États-Unis, d’un côté, et ceux de la Russie
et de l’Iran, de l’autre. « Ceci n’est pas de la
politique, c’est tout simplement de l’appartenance sauvage,
brutale. On défend des intérêts primaires parce
qu’on croit défendre sa famille, son groupe, son appartenance,
ses liens de sang ou parce qu’on est lié à des personnes
qui le font », dit-il.
« Quant à la violence, elle vient du clanisme, de la volonté
de défendre son clan, qui se fait par le sang, alors que les
idées, elles, se défendent par la parole », observe
le sociologue. Dans ce second cas de figure, il n’y a pas d’ennemi,
mais un adversaire, qui peut avoir sa place. Mais aujourd’hui,
dénonce-t-il, « les jeunes n’ont pas d’idées,
ils se contentent de défendre des suiveurs, des hommes qui sont
derrière telle ou telle partie. Ils n’ont d’ailleurs
pas d’idées sur la façon de préserver le monde,
sur la façon de le défendre. Ils veulent alors exclure
l’autre qu’ils considèrent comme leur ennemi, qu’il
soit coreligionnaire ou d’une autre religion ». Et le sociologue
d’expliquer que la religion n’est plus signe de foi, mais
qu’elle devient croyance. C’est là où la violence
se réveille.
« La violence vient également des inégalités
créées par la condition d’appartenance », soutient-il
encore, lorsque la loi est appliquée en fonction des appartenances,
de manière inégale, comme cela s’est toujours passé
au Liban. « La loi n’a jamais été juste dans
ce pays, constate-t-il, parce que l’État de droit n’a
jamais existé. »
Quant à la façon de gérer la violence à
l’université, Abdo Kahi insiste sur la nécessité
d’éliminer le suivisme à l’égard de tel
ou tel dirigeant politique et de revenir à de véritables
questions de nature politique. Des questions qui pourraient notamment
concerner l’environnement ou l’avenir du pays. « Mais
ici, on ne se préoccupe pas de questions pareilles, on n’a
même pas d’ébauches d’idées », déplore-t-il.
Et le sociologue d’expliquer que nous sommes emprisonnés
dans des idées d’appartenance et entraînés
depuis une cinquantaine d’années dans des cycles de violence
dus au conflit israélo-palestinien et des injustices qui en découlent.
Abdo Kahi observe que les universités elles-mêmes n’ont
pas les moyens de régler le problème. « Elles ont
lâché la pensée », déplore-t-il, précisant
que « même dans les campus, il n’y a plus de penseurs,
mais des suiveurs et des techniciens de la pensée ». À
moins d’avoir le courage de rebrancher les étudiants sur
des idées et d’arrêter ce cycle d’appartenance
à des familles, à des groupes de sang. « Mais en
ne politisant pas les jeunes, en ne les poussant pas à créer
des idées, à vivre ensemble, à régénérer
le droit et à ouvrir les espaces de la diversité, les
universités favorisent la violence », accuse le sociologue.
D’ailleurs, constate-t-il, « il n’y a personne pour
mettre les jeunes en garde contre ce suivisme qui engendre la violence
parce que les penseurs sont pris dans le même engrenage ».
L’avenir ? Abdo Kahi le voit sombre, noir. « Je crains la
guerre, comme les autres guerres qui ont ravagé le pays »,
dit-il carrément, tout en affirmant sa volonté, mais en
vain, de régénérer l’esprit civique et le
droit. « Cet esprit civique est en chute libre, déplore-t-il,
et personne ne veut le croire. »
Certes, l’espoir est là. « Il réside dans le
civisme. Il faut pousser les jeunes à quitter leurs clans qui
baignent dans le sang, leur appartenance, pour des idées nouvelles
»,
insiste Abdo Kahi.
Mais les universités en sont-elles seulement capables aujourd’hui
?
|
